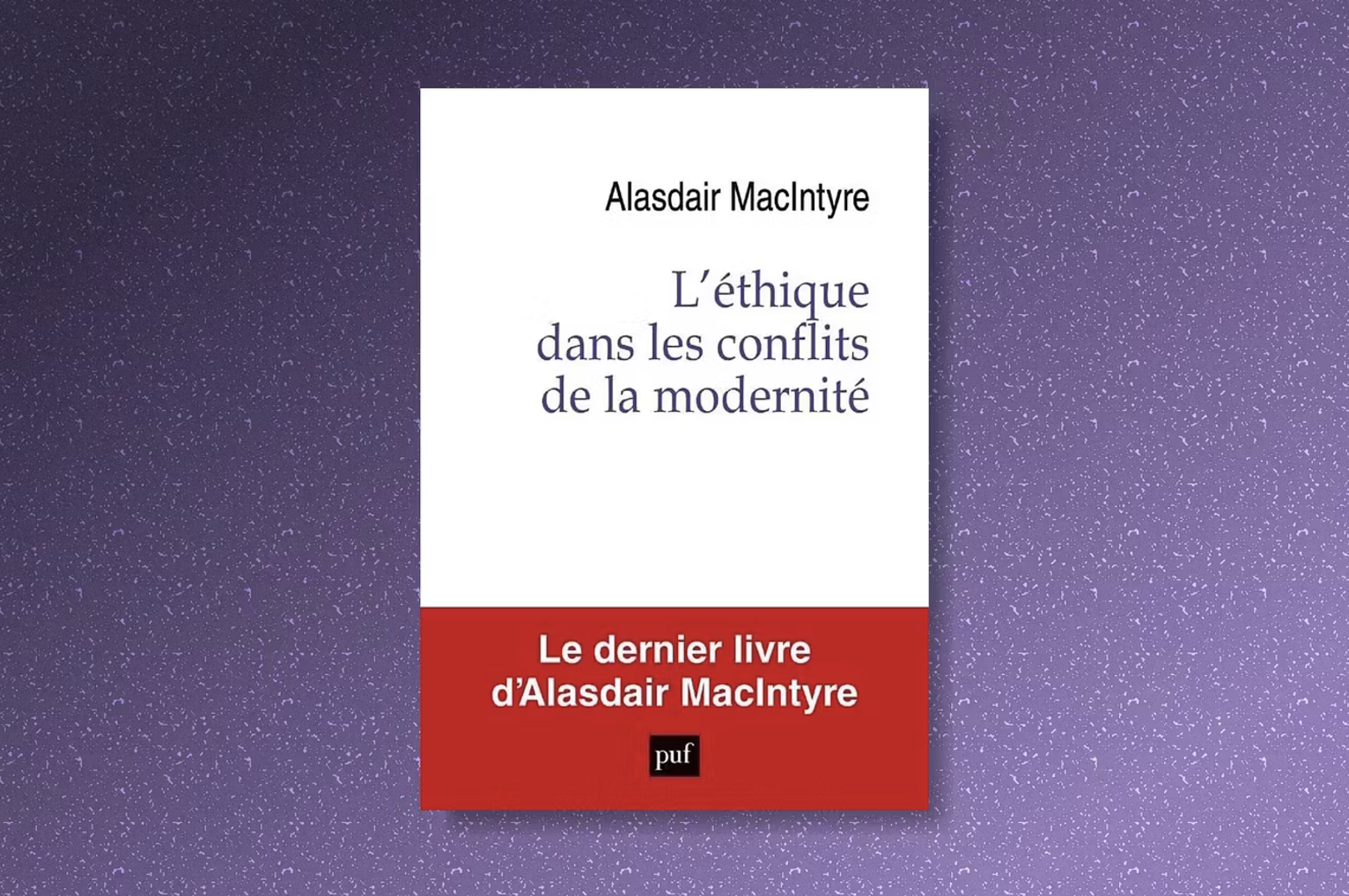LES LEÇONS DU DIEU-SPAGHETTIS
Au commencement était un canular. En 2005, aux Etats-Unis, Bobby Henderson, étudiant à l’université de l’Oregon, invente une religion, le culte du Monstre en spaghettis volant. Selon cette confession parodique, le créateur de l’Univers est un amas de pâtes truffé de deux boulettes de viande. Cet Etre suprême d’un nouveau genre aurait bâti le monde après avoir forcé quatre jours sur la bière, ce qui explique le caractère très approximatif du résultat.
Si ce n’était qu’une blague de potaches, le « pastafarisme » (mot-valise formé à partir de « pasta » et de « rastafarisme ») ne donnerait pas lieu, quinze plus tard, à un essai philosophique. Et pourtant, dans Deus Casino, François De Smet prend cette aventure loufoque comme point de départ de ses réflexions sur les religions, sur la croyance en général et sur leur rôle dans les sociétés contemporaines. Auteur de plusieurs essais remarqués, notamment Reductio ad Hitlerum et Lost ego (PUF, 2014 et 2018), il souligne combien l’histoire de ce culte-farce est déconcertante mais révélatrice, et finalement bien plus intéressante qu’on n’aurait pu le penser.
Premier étonnement : la religion du dieu-spaghettis est officiellement reconnue, aujourd’hui, par plusieurs pays du monde, notamment les Pays-Bas et Taïwan. Des mariages pastafariens sont célébrés. Certaines administrations autorisent les fidèles à conserver, sur leur permis de conduire, leur photo avec passoire sur la tête, symbole de leur foi… Deuxième étonnement : nombre de juristes se trouvent bien embarrassés, pas mal de législateurs aussi. Au nom de quoi, en effet, refuser à cette croyance, même si elle constitue une extravagance revendiquée, le nom de religion ? Sur quel motif lui dénier les droits accordés aux autres ? Les réponses ne sont pas si simples…
La farce comme révélateur
Car le débat ne peut porter sur l’incohérence ou l’invraisemblance du dogme, puisque les religions établies sont dans la même situation. Impossible également de légitimer les fables anciennes pour mieux disqualifier les délires récents. Difficile aussi d’opposer au pastafarisme des arguments scientifiques, dans la mesure où les religions en place soulignent toutes, pour justifier leur légitimité, qu’elles échappent à la réfutation par les faits. François De Smet montre ainsi comment la farce, en l’occurrence, fonctionne comme révélateur.
Ce qu’elle fait voir est bien plus qu’une anecdote. Elle fait office de décapage philosophique, met à nu la part de jeu constitutive du rapport humain au monde. C’est en effet en jouant à se raconter des histoires extraordinaires sur le monde, sur eux-mêmes et sur le destin que les humains forgent des moyens de survivre à leurs angoisses. Puis ils oublient qu’il s’agit d’un jeu. Au bout du compte, ils croient savoir, au lieu de savoir qu’ils croient.
Facile d’accès et stimulant, cet essai appelle une suite, un pas de plus, pour y voir plus clair. Parce qu’on voit mal, au bout du compte, l’issue qu’il propose aux dilemmes qu’il éclaire. Que pourrait bien être une religion qui saurait pertinemment n’être qu’un jeu ? Nous n’avons ni exemple ni réponse. Soit la croyance se prend au sérieux, et elle transforme ses rêveries en réalités supposées. Soit elle revendique son aspect ludique, et elle fait apparaître celui des autres. Concevoir une société sans croyance, un groupe humain sans foi commune, ne semble pas possible.