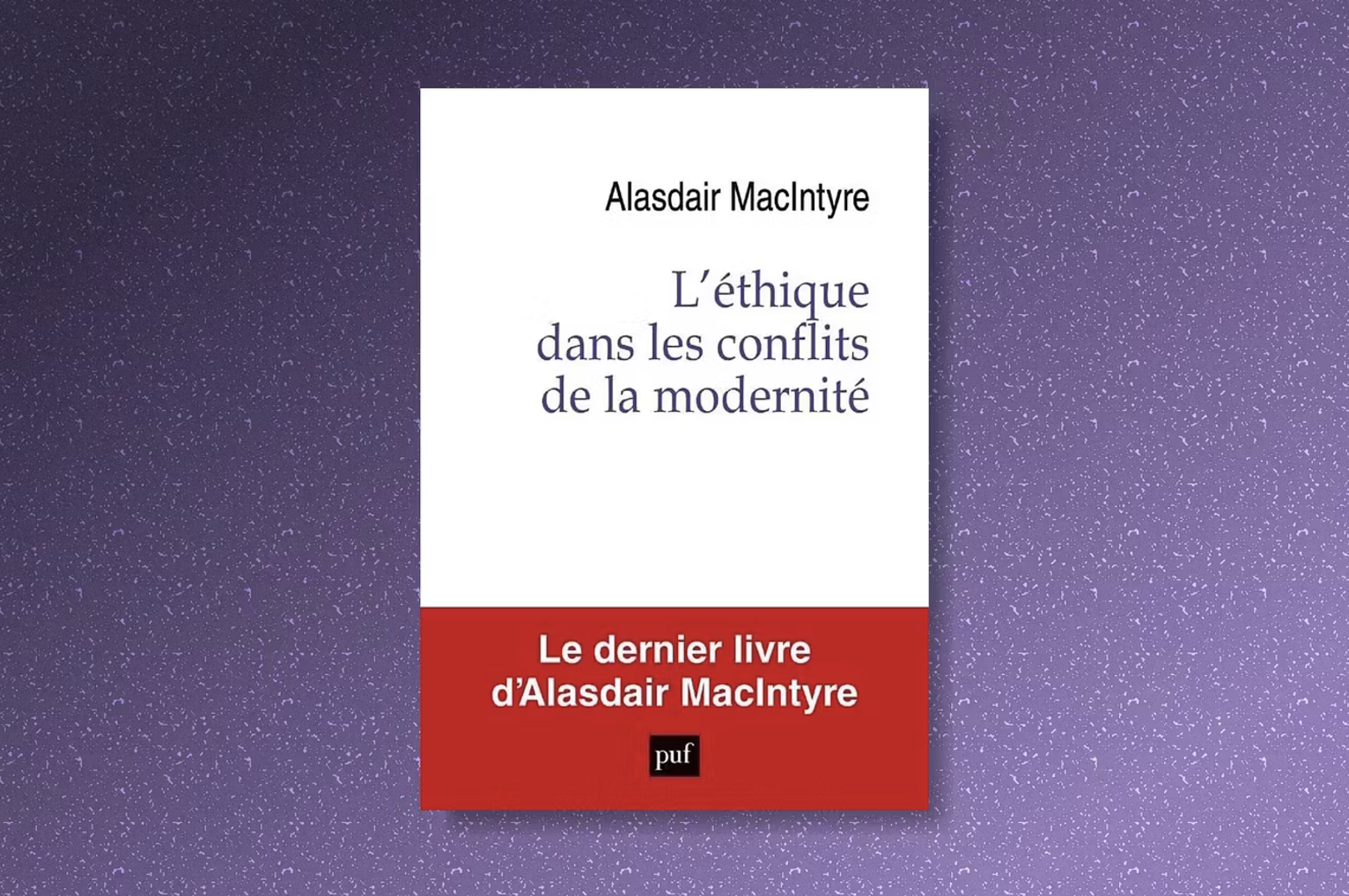L’anachronisme a ses vertus. Dans ce texte rédigé aux environs de 1450, Jupiter a de gros ennuis. Il se voit reprocher son arrogance et son inefficacité. Sa sérénité l’abandonne. Il ne supporte pas les critiques acerbes. Proférées par qui ? Un brailleur aigri, teigneux, ronchon, fouteur de pagaille. Il appelle à se soulever contre les riches, les dominateurs, qui se croient tout permis. Momus, dieu insolent et rebelle, est un insoumis, un indigné. « Montrons que nous sommes des citoyens libres », dit celui-ci, appelant à lutter contre « l’anéantissement de nos libertés » et les rapines des puissants.
Plus on lit Momus, divertissement échevelé du grand humaniste Leon Battista Alberti (1404-1472), plus on a l’impression qu’il parle de notre actualité. C’est une illusion d’optique, mais elle est par moments saisissante. Notre société est évidemment fort dissemblable de celle de Florence, où Alberti a incarné, avant Léonard de Vinci, la figure du créateur omnicompétent, mathématicien, peintre, linguiste, architecte… Mais cet anachronisme est en un sens légitime, puisque l’auteur, dans son prologue, prévient : « Je me réjouirai chaque fois que tu ne pourras t’empêcher de rire. » C’est pourquoi le texte a quelque chose d’universel. Par sa drôlerie, son insolence, ses provocations permanentes. Sa noirceur, aussi.
Car Momus n’est ni un dieu sérieux ni un être respectable. C’est avant tout un agitateur extravagant. Il n’est pas vraiment sympathique, et est même carrément mauvais. Il se définit lui-même « architecte en méchanceté », ce que confirment ses manigances, ruses et coups tordus, qui finissent par mettre l’univers en péril. En fait, ce dieu impie, méprisant les humains autant que les immortels, aime détester et se faire détester. Il se moque de tout et de tous, en particulier de cette race d’hommes qu’on appelle philosophes, qui osent « imaginer des modèles inédits de mondes absolument originaux ».
Fou, débridé et sarcastique
Dans cette satire, on reconnaît la veine bouffonne et savante de Lucien de Samosate (IIe siècle), mais aussi certains jeux qui deviendront, quelques décennies plus tard, ceux d’Erasme dans son Eloge de la folie (1511). Alberti semble toutefois bien plus fou, débridé et sarcastique. Car Momus, finalement, ne laisse rien debout. Finie la grandeur des dieux, Jupiter lui-même n’est qu’une fiction. Finie la dignité des hommes, ce sont tous des filous et des félons. Finies les vertus, il ne reste que l’aigreur et l’absurde, dont on tentera de rire pour n’en pas pleurer.
Voilà pourquoi, sans doute, ce livre ne fut jamais publié par Alberti, qui pourtant le poursuivit et le remania, d’année en année, sans le rendre public. Probablement parce que son contenu, jugé diabolique, lui aurait valu de gros ennuis. Mais aussi parce que si dieux et hommes sont aussi bêtes, veules et cruels que le pense Momus, alors il ne sert à rien de leur expliquer quoi que ce soit…
On l’aura compris : voilà un chef-d’œuvre méconnu à découvrir. Cette première édition critique, texte latin et traduction française en regard, est due aux soins de chercheurs rigoureux, grands spécialistes d’Alberti. On désespérera donc de tout, sauf de l’érudition et de la patience des philologues. Dans la pagaille du monde, les pages des livres bien faits sont des points fixes pour éviter de sombrer. Moralité : seule l’étude console. Voilà, somme toute, ce que soutenait Alberti. Ce qui peut servir encore…