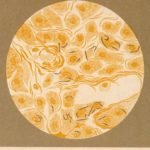« Le Siècle des vérolés. La Renaissance européenne face à la syphilis »

LES AVENTURES DE LA VÉROLE, SAISON 1
La syphilis, maladie réelle, fut aussi un mythe. Près de cinq siècles avant l’apparition du sida, elle a noué l’un à l’autre le sexe et la mort, séparés avant elle. Sa diffusion a transformé les représentations de la jouissance et des prétendus vices, réactivé la misogynie, instauré de nouvelles modalités du soupçon et de l’introspection. Au XIXe siècle, avec Baudelaire, Flaubert, Maupassant et tant d’autres, elle a fini par s’identifier peu ou prou au génie, à la création, à la malédiction sacrée de l’artiste, et a suscité depuis quantité de textes et d’études. On connaît moins, en revanche, ses premières aventures au cours de la Renaissance.
C’est pourquoi on les découvre avec intérêt dans Le Siècle des vérolés, qui ne rassemble pas moins d’une centaine de textes, échelonnés entre 1495 et 1630. Ariane Bayle, maîtresse de conférences en littérature générale et comparée à l’université Jean-Moulin Lyon-III, avec une dizaine de collaborateurs, a en effet ordonné par thèmes une riche moisson d’extraits d’œuvres médicales, morales, poétiques, théologiques, etc. On y croise bien entendu de grands noms (Shakespeare, Rabelais, Erasme, Du Bellay, Cervantès…), mais on découvre aussi quantité d’auteurs oubliés, et leur lot de questions méconnues ou insolites.
En tête de liste, le nom même du mal. « Syphilis » – nom d’un berger contaminé, apparu en 1530 dans le titre d’un poème du médecin et philosophe humaniste Fracastor (1478-1553) – ne s’imposera vraiment que plus tard. « Vérole » est d’abord l’appellation la plus courante, et le reste jusqu’aux Lumières. Parallèlement, on parle en Allemagne du « mal français », en France du « mal napolitain », en Angleterre du « mal espagnol », car la pathologie vénérienne est toujours la maladie des autres. Sa provenance est forcément étrangère, son origine ailleurs.
Réprobation morale
Les auteurs de la Renaissance s’interrogent sur bien des points qui ressemblent de manière frappante à ceux scrutés dans les années 1980 au moment de la découverte du VIH. Ils cherchent ainsi le foyer d’origine (est-ce bien l’Amérique, récemment découverte ?), les modalités de contamination (un baiser, un contact avec les draps peuvent-ils suffire ?), la généalogie des transmissions (par qui passe-t-elle, de soldats à prostituées, d’un pays d’Europe à un autre ?). Ils s’efforcent également d’observer et de classer les symptômes et de comprendre l’évolution du mal. Leurs descriptions cliniques sont hétéroclites, allant des chancres et bubons à la pelade, en passant par la fonte et le pourrissement des chairs, sans oublier… la perte du nez ! Ces tableaux pathologiques se trouvent fortement contaminés par la réprobation morale, qui diabolise la « pute vérolée », fustige les mœurs dissolues et conduit chacun à se défier de ses partenaires, ou à s’interroger sur les conséquences à long terme d’une passade lointaine.
En effet, avec cette pandémie d’un genre nouveau émerge une problématique inattendue. Elle voit s’entrecroiser, selon des axes inconnus auparavant, dissimulation, mémoire intime, rapport à soi. Se mettent alors en place des articulations inédites de l’intime et du social, du visible et de l’invisible, du dicible et du secret. On comprend peu à peu, en lisant cette singulière anthologie, comment, chaque fois, syphilis ou VIH configurent autrement médecine, morale et imaginaire.