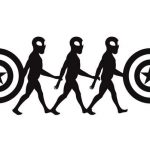Nous, antico-modernes (Le Monde, série d’été) 2/4 Partout des aliens
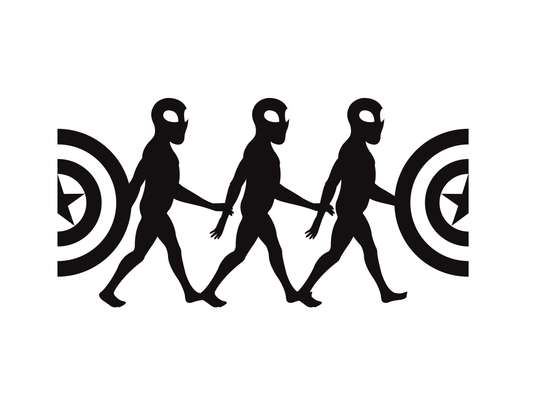
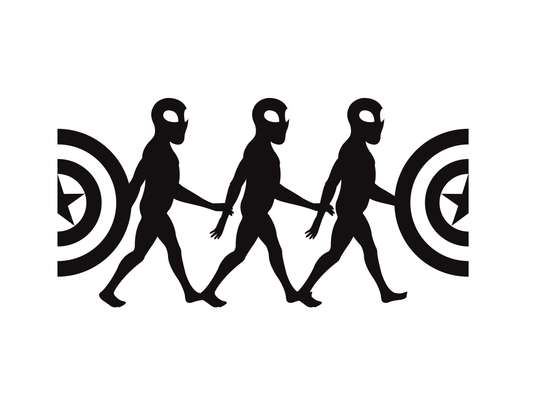
La gueule d’une créature terrifiante, tapie dans un vaisseau spatial, est de préférence bien baveuse. Salive épaisse, visqueuse, qui pend en longs filaments, sous des quantités de dents acérées. Les yeux sont verts ou jaunes, en fentes horizontales, et la peau écaillée. Ce portrait-robot évoque un cousin cosmique des tyrannosaures, parmi les innombrables bestioles fantastiques produites désormais à foison par une série bien coordonnée d’usines à monstres. Elles œuvrent dans le cinéma, la bande dessinée, les jeux vidéo. Des statistiques fiables font défaut, mais on ne se trompera pas en disant que la démographie des créatures terrifiantes est en pleine expansion.
En cela, nous ressemblons de plus en plus aux hommes de l’Antiquité, champions indiscutables des monstres en tous genres. Leur mythologie, leurs épopées, leur littérature regorgent d’animaux divins, lointains, aux propriétés redoutables. Ils ne maîtrisaient ni la 3D ni les effets spéciaux, mais ils avaient de l’imaginaire à revendre, et leurs astuces sont aujourd’hui reprises plutôt que remplacées. Que faut-il donc, pour fabriquer un monstre ? Hier comme à présent, la recette de base est la même : il faut « moins » ou « plus » que la normale.
Un œil en moins, vous avez le Cyclope qu’affronte Ulysse, ou le petit Stuart des Minion, moins redoutable. On recense également quantité d’êtres sans yeux, sans bouche, ou sans jambe. « Les Blémyes (censés vivre en Afrique, « au-delà du désert ») sont dépourvus de tête, ils ont le visage sur la poitrine » explique le géographe Pomponius Mela, au premier siècle. Les peuples des contrées lointaines – Afrique ici, Inde chez Ctésias de Cnide, par exemple – sont imaginés difformes : avec la distance, les critères de l’humain se désorganisent, l’agencement des organes se trouble, n’importe quoi devient possible. Chez Lucrèce, c’est l’éloignement dans le temps, et non dans l’espace, qui fait imaginer des créatures tronquées : au commencement, « on vit des êtres sans pieds et sans mains, ou muets et sans bouche, ou sans regard, aveugles, les membres adhéraient tous au tronc et qui ne pouvaient ni agir ni marcher (…) » (De la nature, Livre V).
Le plus souvent, toutefois, pour faire un monstre, mieux vaut ajouter. De la taille, de la force, donc de la démesure. On change d’échelle, et l’on obtient King Kong ou Godzilla, des vers géants, des insectes plus hauts que des immeubles. On peut aussi multiplier le nombre de bras, de têtes ou de dards. Scylla, dans l’Odyssée, a douze moignons de pieds, six cous géants avec six têtes ayant chacune trois rangées de dents… Enfin, on combine, pour obtenir des mélanges que la nature n’offre pas : le Gryphon, le Sphinx et quantité d’autres qui se retrouvent, sous d’autres formes, mais selon le même principe, dans Star Wars ou Transformers.
Reste à entrevoir pourquoi. On peut en appeler aux grandes constantes de l’imaginaire, mais le constat est faible. Une fois souligné que l’humanité aime se faire peur, qu’elle peuple avec gourmandise les ailleurs – qu’ils soient spatiaux, temporels, sociaux, ethniques – de créatures difformes et effroyables, conformes à ses appréhensions, il reste des questions à creuser. Par exemple : à quoi correspondaient les monstres dans l’imaginaire gréco-romain ? Les nôtres, en recrudescence, disent-ils la même chose ?
La victoire de Zeus sur les Titans, Hercule éliminant l’Hydre de Lerne, le lion de Némée ou Cerbère le chien géant à trois têtes disent l’éradication progressive d’un chaos primordial, la mise en ordre difficile et douloureuse du monde, qu’il soit naturel aussi bien qu’humain. Et les Grecs n’oublient pas combien cet ordre est fragile, exposé aux rechutes. Si les monstres renaissent, s’ils réapparaissent constamment, c’est parce que rien n’est jamais gagné définitivement. D’autant plus que l’inhumain et sa démesure ne sont pas seulement au loin, ailleurs, chez les autres. Cette altérité menaçante est aussi en nous. Des aliens habitent à l’intérieur de nos têtes. Les Anciens savaient cela très bien.
Nous, post-modernes, le redécouvrons, mais différemment. En prenant conscience que nous pouvons provoquer des apocalypses planétaires, en apprenant que nos merveilles techniques sont aussi des maléfices, nous jouons à réveiller les créatures destructrices d’autrefois, et les vaillants guerriers capables de les éliminer. La nuance – elle est de taille – c’est que nos super-héros montrent des signes de fatigue. Ils doutent, échouent, parfois se querellent, bien plus que ceux des Anciens. Ils donnent l’impression de ne pas savoir précisément où ils vont. Ils ne sont plus soutenus par des dieux, discernent de moins en moins le bien du mal, se demandent à quoi servent leurs pouvoirs. En cela, ils parlent d’aujourd’hui.