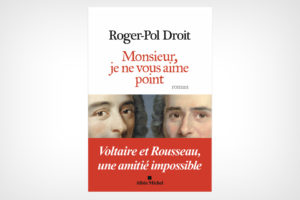Figures libres. Naissance de la philoselfie

La chose, en 2002, existait à peine. Malgré tout, il semble bien que le mot soit apparu cette année-là, sur un forum en ligne australien. « Selfie » a commencé à désigner ces photos de soi prises avec un smartphone et envoyées aux « amis » sur les réseaux sociaux. Les Canadiens, francophones purs et durs, disent bravement « égoportrait » ou « autophoto ». Mais « selfie » – le terme, la chose – a vite raflé la mise : « mot de l’année » en 2013 dans les dictionnaires d’Oxford, il fait son entrée en 2016 chez nos petits, Larousse et Robert, tandis que la tendance se transforme en raz-de-marée : les envois dans le monde se comptent à présent par dizaines de milliards chaque année.
Pareil phénomène n’est donc plus une mode. Plus qu’un simple fait de société, c’est un révélateur inexploré de l’évolution du statut même du sujet. Il en reflète les fragilités nouvelles en même temps qu’il les exacerbe. Voilà qui mérite donc une investigation philosophique d’un genre inédit. Il lui fallait être à la fois théorique et pratique, informée des derniers usages, sensible et subtile, armée pourtant d’outils conceptuels.
Elsa Godart a su répondre à cet exigeant cahier des charges. Psychanalyste et philosophe, la jeune femme, auteure de plusieurs ouvrages, éclaire avec finesse les facettes de cette révolution, dans Je selfie donc je suis. Elle révèle comment, désormais, cette étrange activité incarne, exprime et mobilise une série de relations fluctuantes : à soi, aux autres, au temps, à l’espace, au langage, au désir, à l’esthétique.
Ego-techno
Le voyage organise des rencontres inattendues, confronte Lacan ou Winnicott à Snapchat, Bergson ou Platon à Facebook, Foucault ou Maldiney à Twitter. Non par goût des surprises baroques, mais par souci de comprendre comment bougent nos représentations de nous-mêmes quand le virtuel affecte la société entière. Car le nouveau sujet, celui du selfie, flotte en quelque sorte entre réel et virtuel.
Sa subjectivité lui vient en partie du dehors. Connecté en permanence, voyant se métamorphoser les clivages anciens du lointain et du proche, du « tout à l’heure » et du « tout de suite », de l’invisible et du visible, cet ego-techno dépend de son portrait. Il se cherche dans la diffusion de sa propre image. Son intimité se retrouve au-dehors. Sa présence à soi est conditionnée par la viralité de sa photo, et les « likes » qu’elle suscite ou non.
Le plus intéressant, dans cette tentative de décryptage intelligent des tourbillons de l’époque, est qu’Elsa Godart ne condamne ni n’encense les mutations qu’elle éclaire. Elle en voit certes les risques : narcissisme sans consistance, évanescence du désir, appauvrissement des paroles, concurrencées désormais par le discours en images, le « pic speech » (je ne te dis pas le nom ni le goût de ce que je mange, je t’envoie les photos).
Mais la philosophe ne se résout pas, heureusement, à attendre les barbares en déclarant l’humanité perdue. Au contraire, elle plaide ardemment pour un bon usage du nouveau monde et des sujets en construction. Convaincue qu’il est possible encore de tisser des liens, de réinventer l’amour et le désir, de resubjectiver les êtres snapants, Elsa Godart esquisse ce qu’on devrait nommer une philoselfie. C’est prometteur. Retenez ce nom.
Je selfie donc je suis, d’Elsa Godart, Albin Michel, 224 p., 16 €.