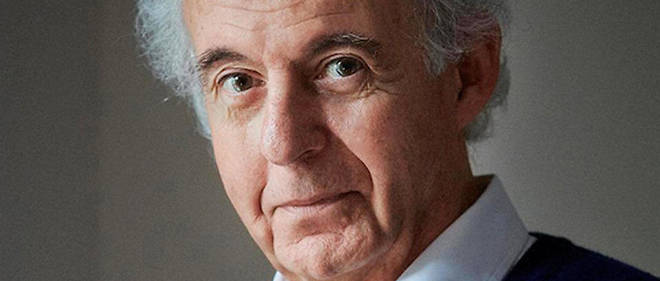Le taureau de Phalaris. Un tyran, un supplice et un paradoxe ouvrent le chemin. Le tyran se nomme Phalaris. Il règne par la terreur et l’assassinat, comme il se doit, et passe pour singulièrement dépravé – on lui attribue une attirance pour le cannibalisme. Cette réputation fait que, dans l’Antiquité, le nom de cet homme, qui régna sur Agrigente au VIe siècle avant notre ère, devint synonyme de cruauté extrême.
Pour plaire à Phalaris, un sculpteur eut une idée de supplice artistique. Il fabriqua un vaste taureau d’airain, aux naseaux garnis de flûtes. Quand le tyran voudra se débarrasser d’un adversaire, il suffira d’introduire ce malheureux dans le taureau et d’allumer le feu sous la statue. Le gêneur meurt atrocement mais, en hurlant, fait résonner harmonieusement les flûtes.
Pour les Anciens, le taureau de Phalaris a symbolisé l’horreur absolue : souffrance sans échappatoire, mort honteuse dans l’obscurité et les suffocations, sous les rires d’un maître sanguinaire. Pourtant, voilà qu’on nous dit que, même dans cette situation de malheur extrême, le sage stoïcien serait heureux ! Bon nombre de textes grecs et latins jusqu’à Cicéron reprennent en effet cette affirmation difficile à croire pour l’homme occidental contemporain.
Voilà donc le paradoxe à examiner. Dans l’agonie la plus effroyable et la plus injuste, comment demeurer inaltérablement serein et souverainement heureux ? Même en faisant sa part à l’exagération, il faut interroger cet exemple. Etre heureux quoi qu’il advienne, est-ce concevable ? Par quels moyens ? Quel genre de bonheur est-ce là ? A ces questions, les stoïciens ont répondu, en paroles et en actes, cinq siècles durant.
Ce qui dépend de nous et ce qui n’en dépend pas. En effet, c’est vers 300 avant notre ère que Zénon de Citium commence à enseigner cette doctrine nouvelle. Il réunit ses premiers disciples, sur l’agora d’Athènes, sous le Portique peint ou Poecile (Stoa Poikilè) – le nom va leur rester : les gens du Portique, stoikoï, les stoïciens. Phénicien d’origine, Zénon est arrivé jeune dans la capitale de la philosophie. Sa cargaison de pourpre s’étant abîmée en mer, il est ruiné mais s’intéresse à la sagesse. Aucun des cours qu’il suit ne le satisfait, pas même le rude enseignement de Cratès, disciple de Diogène. C’est pourquoi il finit par fonder sa propre école, destinée à changer de vie plutôt qu’à discourir. Le succès du stoïcisme commence : » Il enseigne la faim et trouve des disciples « , souligne une comédie de l’époque.
Quelques siècles plus tard, quand l’empereur Marc Aurèle meurt sur les bords du Danube, en 180 de notre ère, le stoïcisme est une doctrine au faîte de sa gloire. Elle rassemble les meilleurs esprits de Rome, influence d’innombrables oeuvres. Les bases jetées par Zénon demeurent, mais l’école de sagesse des gens du Portique a connu une série de métamorphoses qui mettent de plus en plus l’accent sur son éthique.
La manière la plus simple de l’aborder est fournie par Epictète. Ancien esclave, cet homme austère enseigne, vers le début du IIe siècle de notre ère, les moyens d’atteindre le bonheur dans un monde hostile. Leçon 1 : discerner clairement entre les faits et nos représentations. L’essentiel ne se joue pas dans les circonstances, mais dans ce que nous en pensons. J’ai un accident, je suis blessé, il m’en restera des séquelles – voilà des faits, je n’y peux rien. En revanche, vivre cette épreuve comme une catastrophe déprimante ou comme un défi stimulant, pour Epictète, cela ne dépend que de moi.
Règle d’or de ce stoïcisme : distinguer entre ce qui dépend de nous et ce qui n’en dépend pas. Notre volonté, nos pensées, nos représentations et nos jugements sont en notre pouvoir. Pourquoi ? Parce que nous sommes, par nature, des êtres doués de raison : la raison en nous commande si rien ne l’entrave. Nous sommes donc radicalement libres, au sens où rien au monde ne peut faire plier notre volonté ni manipuler notre pensée. Impossible de faire que nous voulions ce que nous ne voulons pas. La volonté pensante est une forteresse.
Le tyran peut toujours menacer, emprisonner, torturer, exécuter ; jamais il n’aura le pouvoir de faire que je ne pense pas ce que je pense. Ce que je veux, juge et décide ne dépend que de moi. Ce principe directeur interne est notre » citadelle intérieure « . Inexpugnable et invincible. Reste à savoir comment elle peut nous préserver du malheur, et si cela suffit à être heureux.
Au début du » Manuel » d’Epictète, la liste des choses qui » ne dépendent pas de nous « peut surprendre : le corps, la richesse, la réputation, le pouvoir. Il semble évident que nous ne sommes pas dépourvus d’action dans ces domaines. Ne faisons-nous pas ce que nous pouvons pour être en bonne santé ? Pour améliorer nos revenus, pour éviter la misère ? Du coup, on peut avoir du mal à comprendre que tout cela ne dépende pas de nous. En fait, jamais les stoïciens ne nient l’existence de ces actions ni ne conseillent de les abandonner. Ce qu’ils soutiennent est plus subtil. Quels que soient nos efforts pour être prospère, le résultat n’est jamais garanti. Par définition, nous ne maîtrisons pas le hasard : malgré nos soins, peuvent nous tomber dessus maladie, misère, calomnie, disgrâce.
Le bonheur ne peut donc être assuré par aucune circonstance extérieure – qu’elle soit corporelle, financière ou sociale. Nous ne contrôlons absolument que notre volonté pensante. C’est donc elle seule qui doit pouvoir nous permettre d’être heureux, dans toutes les situations, même les pires. Ainsi, quoi que le sort lui réserve, le sage stoïcien va pouvoir demeurer inaccessible au malheur. Il peut être, comme dit Epictète, » malade et heureux, en danger et heureux, mourant et heureux, exilé et heureux, méprisé et heureux « .
Le contresens : imaginer le stoïcien masochiste. Croire que la souffrance le rend heureux serait une complète erreur. En fait, la douleur lui est aussi indifférente que le plaisir : dans ce domaine, rien ne l’atteint, car tout ce qui est hors de notre pouvoir lui paraît indifférent. Mais il n’entre aucune volonté de mortification dans cette stratégie de séparation radicale entre circonstances et jugements. Les stoïciens parviennent même à combiner l’ » indifférent « et le » préférable « . Sauf cas particulier, rechercher la maladie, la misère ou l’humiliation est insensé. Santé, richesse, pouvoir sont donc préférables. Mais, d’un autre côté, ce sont aussi des choses indifférentes, car leur perte aux yeux des stoïciens est sans conséquences : ces éléments extérieurs ne conditionnent pas leur bonheur.
Citadelle intérieure. Protégé des fluctuations du hasard, blindé contre les coups du sort et les revers de fortune, voilà donc notre stoïcien… stoïque – impassible et indestructible. Mais heureux ? En quel sens ? Pour l’entrevoir, il reste à faire un autre chemin. Car le sage ne s’est pas seulement soustrait au malheur, mais de manière positive il veut le bien, pratique la vertu, aime la totalité du cosmos et vit selon la nature. Pour lui, ce ne sont pas là des activités distinctes, mais une seule et même façon de conduire son existence – en l’occurrence, celle qui rend heureux.
Assurément, ce bonheur du sage est loin de ce que nous nommons communément par ce terme. Dans la conception usuelle, il entre toujours une part de plaisir et une part d’aléatoire – qui rend à nos yeux le bonheur toujours fragile, exposé, destructible. Aristote, dans l' » Ethique à Nicomaque « , est plus proche de cette vision commune que les stoïciens : un homme heureux se reconnaît selon lui à une certaine combinaison d’honnêteté, d’aisance matérielle et de reconnaissance sociale. C’est seulement après sa mort qu’on pourra dire que sa vie a été heureuse car, tant qu’il vit, un cataclysme peut tout remettre en question, transformer en naufrage cette existence réussie. Aux yeux d’Aristote, si la vertu est bien une condition nécessaire du bonheur, elle n’est pas suffisante. Au contraire, aux yeux des stoïciens, la vertu suffit entièrement à être heureux. Mais qu’est-ce que cela veut dire ?
Le coup de génie de Zénon de Citium fut de faire fusionner la raison, la nature et le bien. C’est une seule et même chose, pour un stoïcien, de vivre selon la raison et la nature. Le sage, en désirant le bien, ne veut rien d’extérieur au monde, rien même de différent de ce qui est. Il ne veut pas autre chose que l’ordre du monde tel qu’il est, dans sa cohérence profonde et son harmonie intelligente. Car, à la base du stoïcisme, se tient la conviction que le cosmos est ordonné, que tout s’y enchaîne et qu’il appartient à chacun d’y jouer sa partition. La vertu n’est rien d’autre, et elle émane de nos instincts, si nous savons les comprendre.
Nous nous trompons donc si nous imaginons que la » vertu » consiste à suivre un idéal, un modèle hors du monde, une valeur transcendante. Ce n’est pas du tout ce que les stoïciens ont en tête. La vertu, finalement, n’est pour eux rien d’autre que la vie, conduite selon cette vue exacte que la raison nous permet d’avoir de la nature et de nous-même. Si la vertu procure le bonheur, ce n’est donc pas comme conséquence d’un moralisme. Le bonheur n’est pas la récompense du vertueux, un supplément résultant de sa bonne conduite. Pour les stoïciens, il est rigoureusement identique à la vie sage et ne s’en distingue pas. Ce n’est donc pas un bonheur simplement négatif. L’accent mis sur l’absence de troubles (l’ataraxie) et l’absence de passions (l’apathie) risque de faire oublier qu’il ne s’agit pas seulement de se soustraire au malheur. Le stoïcien est heureux parce qu’il ne fait qu’un avec l’ordre du cosmos. Le malheur des hommes : ne pas se servir de leur raison, se tromper de bien, poursuivre des chimères en les croyant réelles. Le bonheur du sage : ne vouloir que le bien, comprendre l’ordre du monde et la place de chacun, acquiescer au destin.
La citadelle intérieure n’est donc pas seulement un refuge. C’est un lien avec le monde et les autres. Ce n’est pas par hasard que les stoïciens ont insisté sur le cosmopolitisme, l’égalité des hommes, la dignité des esclaves et la participation du sage aux affaires de la Cité. L’entente et la coopération appartiennent à l’ordre de la nature – il convient de les restaurer chaque fois que les égarements de la civilisation viennent les perturber et menacent de les détruire.
Néostoïcisme. Retournons par la pensée dans le taureau de Phalaris. La porte s’est refermée, l’obscurité règne, la chaleur des flammes commence à rendre brûlante la paroi d’airain. En quel sens le sage stoïcien, ici même, est-il heureux ? Il continue à ne vouloir que le bien, à comprendre l’inéluctable enchaînement des événements du monde. La douleur n’entame en rien la clarté de sa vision. La mort ne l’impressionne en aucune manière. Le tyran peut se croire vainqueur. C’est le sage qui l’emporte.
Transposer ce dispositif à notre époque n’est pas impossible. Qu’on songe aux pires moments du XXe siècle : les Phalaris furent légion, les horreurs inventives extrêmes. Les héros des résistances sont de lointains descendants des sages stoïciens. Les uns comme les autres sont capables de tout sacrifier à une seule cause, de ne pas trembler face à la mort, de ne rien avouer sous la torture. Toutefois, si nous vénérons l’héroïsme de ces résistants, leur courage et leur dignité, nous ne les dirons pas heureux. Plutôt sublimes. Car le bonheur est pour nous plus humble et plus frêle, plus bêtement humain.
Faut-il en conclure que la grandeur paradoxale du bonheur stoïcien appartient à l’histoire de l’Antiquité ? Sommes-nous réduits à seulement l’étudier, comme une sorte de chantier archéologique, énigmatique et lacunaire, que plus personne n’habite depuis des millénaires ? Ce n’est pas certain. Car notre époque est suffisamment anxiogène et chaotique pour inciter au refuge en soi-même. Comme, en outre, le sens de la nature s’aiguise à nouveau, que la réflexion sur les vrais et les faux biens retrouve de la vigueur, des ponts s’esquissent entre citadelle intérieure et ordre cosmique. Un néostoïcisme n’est pas impossible.
D’Athènes à Rome
L’histoire du stoïcisme s’étend sur plusieurs siècles, passe de la Grèce antique à l’Empire romain et intègre des apports d’autres écoles. Elle demeure souvent malaisée à établir dans le détail, la plupart des oeuvres étant perdues. On distingue trois périodes.
L’ancien stoïcisme Se développant à Athènes aux IIIe et IIe siècles avant notre ère, il est marqué par trois figures principales. Zénon de Citium,le fondateur, pose les principes de l’école, notamment l’existence d’un ordre rationnel du monde et le souci de vivre en accord avec cet ordre. De la vingtaine d’ouvrages qui lui sont attribués, dont on connaît les titres, quasi tout a disparu. Subsistent les témoignages recueillis par Diogène Laërce ( » Vies, doctrines et sentences des philosophes illustres « , Livre VII, I-36) et des citations. Cléanthe d’Assos lui succède, éloigne l’enseignement de Zénon des cyniques et engage le stoïcisme dans une voie plus théorique. On ne conserve qu’une quarantaine de vers d’un » Hymne à Zeus « . Chrysippe de Soles, qui prend ensuite la tête de l’école, passe pour avoir donné à la philosophie stoïcienne son ampleur et sa technicité. Il serait l’auteur de plus de 700 traités, dont il ne reste que de rares fragments, sur les trois parties de la philosophie déjà distinguées par Zénon : logique, physique et éthique. Sa contribution fut décisive dans l’élaboration de la logique stoïcienne, dont l’importance a été redécouverte par la pensée contemporaine. Les fragments dispersés de ces auteurs ont été rassemblés par H. von Arnim dans les quatre volumes de ses » Stoicorum Veterum Fragmenta » (Fragments des anciens stoïciens) publiés à Leipzig entre 1903 et 1924.
Le moyen stoïcisme Au cours du IIe et du Ier siècle avant notre ère, des échanges multiples intègrent au stoïcisme des éléments venus des doctrines d’Epicure, de Platon, d’Aristote, et aussi des pensées orientales, en particulier dans l’école » syriaque « , où s’illustrent Panetius de Rhodes et Posidonius d’Apamée. Par leur intermédiaire, les Romains accèdent à la pensée stoïcienne. Notamment Cicéron, qui consacre au stoïcisme de longs exposés ( » Des devoirs « , » Du destin « ).
Le stoïcisme impérial Du Ier au IIIe siècle de notre ère se développe une renaissance de la pensée stoïcienne, caractérisée par l’accent mis sur la conduite personnelle et sa dimension éthique. Ce dernier développement du stoïcisme antique est le mieux connu, parce que nous possédons les textes majeurs où il s’est exprimé, qui sont aussi, littérairement, des chefs-d’oeuvre. Trois grands noms y sont attachés. Sénèque, venu à la philosophie en amateur, finira par y exceller. La plupart de ses traités ( » De la vie heureuse « , » De la constance du sage « ) se lisent avec plaisir, et ses » Lettres à Lucilius » sont un des monuments de la littérature. Epictète, esclave affranchi ayant ouvert une école, nous est connu par la rédaction de son enseignement via l’un de ses disciples. Dans ses » Entretiens » et son » Manuel « , on découvre la portée pratique de la doctrine. Marc Aurèle, empereur de 161 à 180, fut un philosophe tenant son rôle d’empereur plutôt qu’un empereur s’intéressant à la philosophie. S’efforçant de vivre en conformité avec ses convictions, il rédige au jour le jour ses » Pensées pour moi-même « , l’un des textes majeurs de l’histoire de la pensée.