Tous rivaux, tous rassemblés
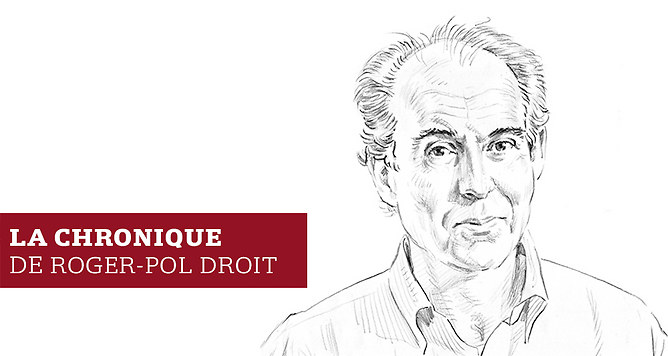
Fabien Clairefond pour Les Echos
On pourrait trouver catastrophique le paysage politique que cette campagne présidentielle donne à voir. Emiettement, querelles intestines, conflits de carrières, « affaires », réelles ou supposées, masquent durablement les questions décisives et les enjeux cruciaux. Partout, fractures et divisions. La droite, qui vient de frôler la cassure, s’efforce de recoller les morceaux. L’extrême gauche n’y parvient pas, et demeure disjointe. Le centre se montre tiraillé entre des sensibilités et des références contraires. L’extrême droite, en apparence moins fragmentée, n’en est pas moins travaillée de tensions internes. Au lieu de se lamenter de ces cacophonies, il faut s’efforcer d’en comprendre les raisons. Ce ne sont pas les explications qui manquent.
Au contraire, il y en a presque trop. En passant par la politologie, on décortiquera les effets pervers des primaires, le passage de deux blocs à quatre, la défiance envers les élites, la vogue de « l’anti-système ». Avec la sociologie, on insistera sur la césure de la France entre les groupes de connectés-mondialistes et les populations périphériques, délaissées et dépitées, on rappellera le rôle croissant du numérique et des réseaux sociaux dans la versatilité de l’opinion. En recourant à l’économie, on montrera le décrochage constant de l’industrie française, le poids de la dette, l’inadaptation des structures. Cette énumération peut se poursuivre, et ces multiples analyses ne sont évidemment pas fausses. Chacune recèle sa part de vérité. Toutes omettent, malgré tout, une dimension plus générale – philosophique, en fait – relative à la démocratie et à la nature humaine.
Depuis Platon, une réflexion aiguë s’est constituée en Occident sur les régimes politiques, leurs travers, et les remèdes possibles pour les supprimer. Au cœur de ces analyses, bien sûr très diverses, on trouve toujours la relation conflictuelle entre les ambitions personnelles et le bien commun. Désirer le pouvoir n’est pas désirer l’harmonie de la Cité. Sous les discours vertueux, les bonnes intentions affichées, la lutte se poursuit, à l’intérieur. En grec ancien, on désignait cette tension interminable par le terme de stasis, rendu en français tantôt par « sédition », tantôt par « trouble » ou par « émeute ». Aucune de ces traductions ne rend avec exactitude la dimension d’affrontement continu, de clivage permanent que la notion évoque.
En fait, les auteurs antiques ne voient aucune différence décisive entre stasis et polemos, la guerre. Ils n’ignoraient certes pas la distinction opposant guerre « civile » et guerre « entre cités », mais ce n’est à leurs yeux que deux modalités d’une même déchirure sans fin des communautés humaines. La guerre « de tous contre tous » que Hobbes imagine en l’absence d’un pouvoir central (bellum omnium inter omnes) ne cesse pas une fois l’Etat constitué. Elle se poursuit, feutrée, larvée, mais incessante. Chacun demeure adversaire et rival de celui qui est devenu son compatriote, son concitoyen, son partenaire.
Cette « insociable sociabilité des hommes », comme disait Kant, est plus visible et plus vive dans les démocraties que partout ailleurs. Platon, qui haïssait le désordre démocratique, imagine avec La République un système politique idéal : justice et vérité s’y imposent aux passions humaines, régularisent leur désordre. L’harmonie règne enfin… mais au prix d’un totalitarisme sans faille, d’un contrôle étouffant des comportements et des pensées. Dans une démocratie, aucune vérité n’est au poste de commande. Seule décide la règle majoritaire, et les rivalités entre les personnes, comme entre les groupes, se donnent plus libre cours.
Il n’en reste pas moins que les uns ont besoin des autres. La nécessité des alliances, accords et rassemblements s’impose à des humains qui n’en restent pas moins concurrents, désireux chacun de son intérêt. Ils s’assemblent, mais par calcul, par crainte ou par ambition. On se souvient de la fable des hérissons en hiver, reprise par Schopenhauer : pour se réchauffer, ils se serrent les uns contre les autres, et enfoncent alors leurs aiguilles dans la chair de leurs congénères. Eloignés, ils gèlent. Rapprochés, ils se blessent. Vu sous cet angle, le spectacle des élections présidentielles ne serait pas une désolation. Juste une leçon de philosophie. Ou plutôt d’une des branches de la philosophie, celle qui trouve sa vocation dans le désenchantement. Heureusement, il y en a d’autres.





