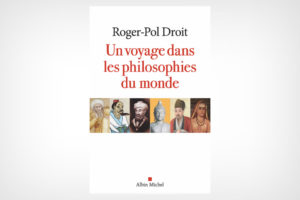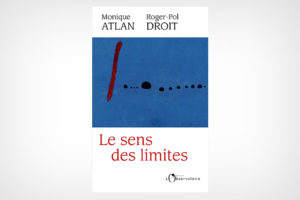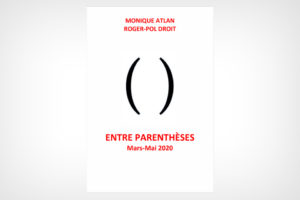Chacun de nous est-il une fiction ?

Shantarakshita
Nom, prénom, date de naissance, domicile, profession… Vous pouvez ajouter des événements marquants de votre existence, esquisser vo parcours, réussites, échecs, décisions majeures…. Vous savez donc qui vous êtes. Du moins, vous le croyez. Ces données vous constituent en tant qu’ « ego », instance de réflexion et de choix, humain sachant dire ce qu’il accepte ou refuse, pour qui il vote ou ne vote pas, ce qu’il défend ou combat. Voilà, en fait, la condition moderne de la démocratie, du droit, de la morale, de l’économie : il existe des « ego », capables d’opérer souverainement des choix rationnels dont ils seront tenus pour responsables. Sous des noms divers (« citoyens », « personnes », « sujets de droit », « acteurs rationnels »), le dispositif est toujours identique.
Et si ce n’était qu’une fiction ? Une fable qu’on se raconte, afin d’éviter de voir le réel de nos vies, qui n’a rien à voir avec cette belle clarté du libre arbitre. Car ce réel semble plutôt fait de chaos, de hasards, de discontinuités, d’automatismes. De soumissions grégaires, plus que de libertés rebelles. De confusions multiples plus que d’idées claires et distinctes. « Ego est le nom de l’histoire que je me raconte en permanence » écrit François de Smet. Ce philosophe belge, auteur d’une dizaine de livres, dont Reductio ad Hitlerum. Une théorie du point Godwin (PUF, 2014), également scénariste et chroniqueur, rassemble avec une grande clarté, dans Lost Ego, un faisceau d’arguments – empruntés aux classiques comme aux recherches contemporaines – contre l’existence de l’Ego.
Spinoza et Schopenhauer sont convoqués en critiques du libre arbitre, mais aussi la psychologie expérimentale et les sciences cognitives. Les célèbres expériences conduites par Stanley Milgram ont établi combien les individus se débarrassent vite de leur autonomie pour se plier à l’autorité. Au lieu de décider ce que nous voulons, le plus souvent nous suivons ce que font les autres. Ce comportement nous protège et nous avantage : le vrai confort, c’est le conformisme. Et quand nous nous pensons libre, nous obéissons à nos impulsions, nos coups de cœur, caprices et tocades. Conduits ainsi par l’arbitraire, opaques à nous-mêmes, nous construisons – mais après-coup ! – des trajectoires sensées et des décrets souverains.
Cette argumentation n’est pas neuve, mais François de Smet l’actualise avec talent. Il manque toutefois des analyses qui auraient apporter quantité d’eau à son moulin, celle des anciens traités bouddhistes indiens. Sans doute est-il vain de déplorer ce qui ne figure pas dans un essai par ailleurs bien construit. Et pourtant… S’il y a une tradition intellectuelle qui a pris pour axe central l’inexistence de l’Ego, qui a eu pour souci constant la démonstration de son caractère fictif, c’est bien celle-là. Dans les traités du Petit Véhicule traitant de la théorie de la connaissance, dans l’Abhidarmakosa de Vasubhanbdu, dans les œuvres de Nâgârjuna, dans les sommes de Chandrakîrti et de Shantaraksita – entre autres -, l’illusion de l’Ego se décortiquée, la constitution de sa fable passée au crible, ses effets funestes minutieusement décryptés. La construction de cette fiction par la mémoire et le récit est expliquée par le menu. Et ces lointains traités se révèlent, en outre, neuro-compatibles !
LOST EGO
La tragédie du « je suis »
de François de Smet
PUF, « Perspectives critiques », 134 p., 16 €