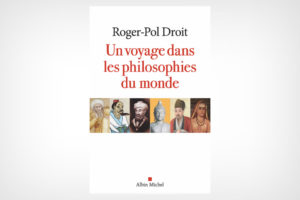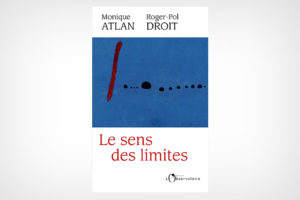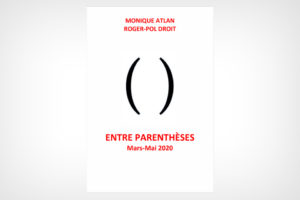Figures libres. Le réveil de l’utopie
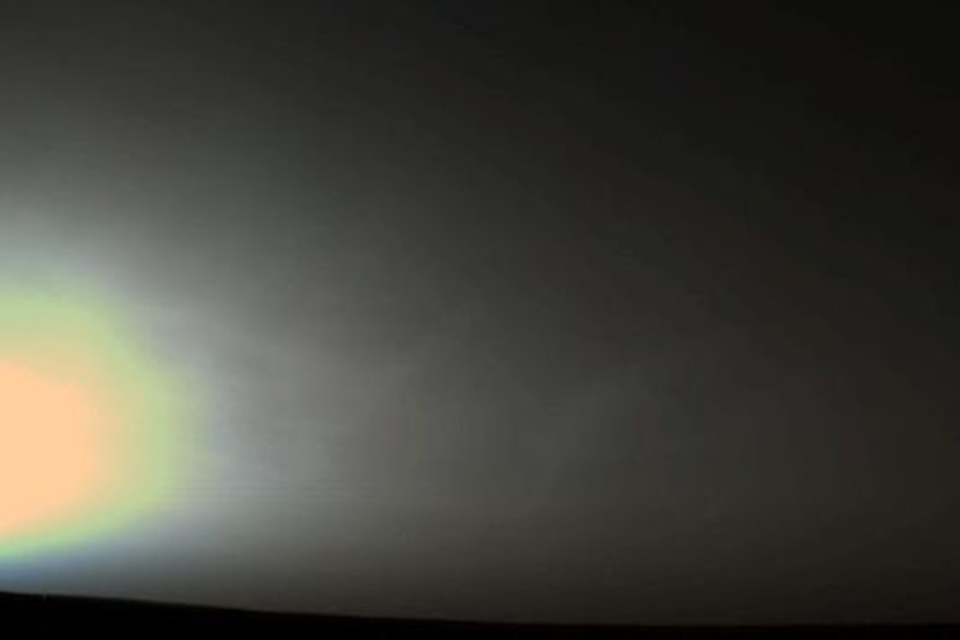
Il y a juste cinq cents ans, en 1516, Thomas More publiait son célèbre Utopie, récit d’un voyage imaginaire dans une île coupée du monde dont les habitants mènent une vie juste, sage, heureuse… humaine. Il inventait le mot, qui désigne littéralement un « non-lieu » (à partir des termes grecs ou, marquant la négation, et topos, l’endroit). Mais la chose existait déjà de longue date. Depuis La République, de Platon, et les Voyages extraordinaires, de Lucien de Samosate, l’Antiquité connaissait des descriptions détaillées de sociétés idéales. Les Temps modernes, en particulier au XIXe siècle, ont vu proliférer les utopies, mêlant critique sociale, espoirs révolutionnaires, inventions de nouveaux mondes humains. Jusqu’à ce que Marx les critique, au nom de la science, montrant leur caractère irréaliste, illusoire, voire dangereux. Commença alors un grand sommeil, agité parfois de soubresauts, mais durable.
A quelles conditions l’utopie peut-elle se réveiller ? De quoi au juste est-elle porteuse ? Pourquoi donc est-elle indispensable ? Le philosophe Miguel Abensour a consacré son œuvre à ces questions. L’essentiel de ses réponses, des années 1970 à maintenant, est republié, depuis 2013, en cinq volumes, par les éditions Sens & Tonka. En attendant le dernier volume (Essai sur le nouvel esprit utopique), qui reste à paraître, la quatrième livraison porte sur L’Histoire de l’utopie et le destin de sa critique. Abensour y revient sur les analyses de Marx, montrant, par exemple, comment l’opposition entre théorie scientifique et rêverie utopique n’est pas, comme on l’a cru à tort, l’élément décisif. Plus importante serait la distinction entre deux types d’utopie : reflets de la société présente, ou bien préfigurations d’un monde nouveau.
Les jeux multiples du réel
De texte en texte, Miguel Abensour, ancien président du Collège international de philosophie, directeur depuis 1974 de la grande collection « Critique de la raison politique » chez Payot, professeur émérite de philosophie politique à l’université Paris-VII-DenisDiderot, ne cesse d’entretenir la flamme de l’utopie. Mais jamais comme celle du Soldat inconnu, dans un esprit de commémoration figé. Ce qui l’intéresse, au contraire, ce sont les futurs possibles et les jeux multiples du réel et d’un « impossible » capable malgré tout d’advenir. Contre une philosophie politique qui ne se veut plus que réaliste, ce philosophe est de ceux qui n’ont cessé de vouloir redonner sa chance à l’émancipation. A contre-courant, longtemps. Il se pourrait, toutefois, que l’histoire de nouveau se transforme.
Des signes d’éveil des utopies se repèrent un peu partout, tressant le meilleur et le pire. Du film Demain, de Cyril Dion et Mélanie Laurent (2015), au mouvement Nuit debout, des mondes virtuels aux fictions du transhumanisme, les rejetons de l’utopie émergent de mois en mois. Il convient donc d’y rester attentif, d’en saisir les enjeux, les pièges, les chances. Mais, comme son histoire est immense, ses ambiguïtés multiples, ses résurgences souvent déconcertantes, il faut des boussoles. Celles proposées par l’œuvre de Miguel Abensour ne sont pas les seules possibles, cela va de soi. Toutefois, si l’on veut comprendre, dans le détail, comment s’organisent les cartes mentales où figure cette île invisible nommée Utopie, ce sont des boussoles indispensables.
L’Histoire de l’utopie et le destin de sa critique. Utopiques IV, de Miguel Abensour, Sens & Tonka, « Sciences sociales », 146 p., 14,50 €.