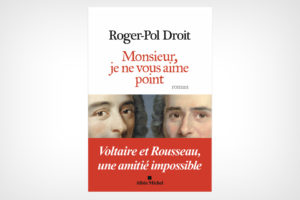Figures libres. Quand le Bouddha arriva en Chine

Il fallait passer par l’Afghanistan, la chaîne de l’Hindu Kuch, les Pamir, les déserts, jusqu’à Dunhuang, où les falaises alentour étaient truffées de grottes creusées pour héberger les moines. D’autres routes, moins fréquentées, partaient de l’Assam, par la Birmanie et le Yunnan, ou bien du Népal, par le Tibet. Dans tous les cas, aller de l’Inde jusqu’en Chine, dans l’Antiquité, était un long périple, hasardeux et harassant, qui se menait à pied, à mulet, en bateau parfois, depuis le golfe du Bengale. Ces diverses routes furent empruntées par des centaines et des milliers de moines, au fil des premiers siècles de notre ère. A terme, l’histoire de l’empire du Milieu en a été profondément transformée.
Cette page essentielle de l’histoire du monde reste souvent méconnue. Elle est pourtant aussi décisive et complexe que celle, bien plus familière aux lecteurs occidentaux, qui vit se rencontrer l’univers gréco-latin et le judéo-christianisme. Ces deux événements ne sont certes pas en tout point comparables. Toutefois, mutatis mutandis, l’implantation progressive du bouddhisme – indien par sa naissance, mais aussi sa langue, le pali, par ses schémas mentaux et culturels – dans la Chine taoïste et confucianiste généra une confluence tumultueuse, compliquée, passionnante à comprendre. Sauf qu’il s’agit d’un vrai casse-tête, quand on ne dispose pas d’une synthèse bien faite. Pour s’y retrouver, entre les rapprochements et les tensions, la multitude des écoles, les centres de traduction, les périodes de persécution et celles d’efflorescence, les âges d’or et les déclins, les renaissances et les syncrétismes, une vie en bibliothèque est exigée. Ou bien un guide dévoué. C’est le cas de l’Américain Kenneth Ch’en, qui semble avoir tout lu – en chinois, en japonais, en anglais – et compose un exposé lumineux, précis et subtil.
Querelles et disputes
Issu d’une série de conférences données à l’université de Princeton au début des années 1960, ce fort volume, publié aux Etats-Unis en 1964, n’aura attendu qu’un demi-siècle d’être mis à disposition des lecteurs francophones. Heureusement, il n’a pratiquement pas pris de rides, et une utile actualisation de la bibliographie le botoxe définitivement. Au fil des pages se font de nombreuses découvertes : figures de moines-philosophes, d’ermites lettrés, de passeurs de textes – comme Kumârajîva, moine indien qui apprit le chinois et produisit une quantité impressionnante de traductions –, sujets de querelles et de disputes savantes, notamment autour de la nature du nirvâna ou encore du caractère « graduel » ou « subit » de l’Eveil, périodes de concorde avec les taoïstes et les confucéens ou de relative clandestinité des bouddhistes en raison de flambées de proscription.
Quand le Bouddha arriva en Chine, perché sur l’épaule d’un disciple quelconque, quelque part au Ier siècle avant notre ère, il ne se doutait pas, si omniscient qu’on voudra bien l’imaginer, de tout ce qui l’attendait. Il ne prévoyait guère, par exemple, de se retrouver, au bout d’un petit millénaire, chauve, ventripotent et rieur. Pourtant, sous les Song, il est devenu courant de le représenter ainsi – bedonnant, rigolard. Cette image du Bouddha, bien peu indienne, a perduré, en Chine, jusqu’à nos jours. Elle doit l’essentiel de ses traits à « Sac de toile », un moine mythique. Pour savoir comment se fit au juste pareille métamorphose, voyez Kenneth Ch’en.
Histoire du bouddhisme en Chine (Buddhism in China. A Historical Survey), de Kenneth Ch’en, traduit de l’anglais (Etats-Unis) par Dominique Kych, bibliographie additionnelle de Sylvie Hureau, Les Belles Lettres, 588 p., 35 €.