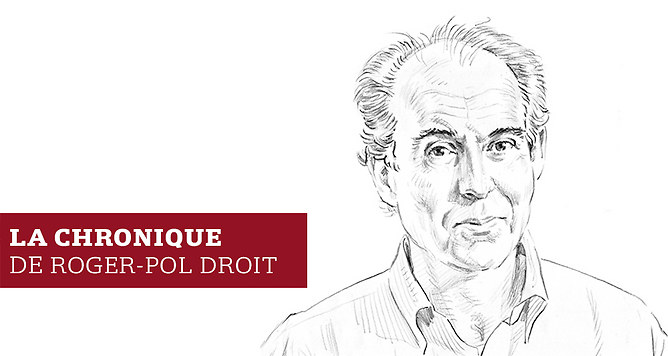
Au début de cette semaine, 124 professionnels de santé ont lancé une vigoureuse alerte contre les « médecines alternatives ». Leur but : alerter, une fois de plus, contre les risques engendrés par des thérapeutiques dont les effets ne sont pas rigoureusement prouvés, et qui relèvent donc du registre des croyances plutôt que de celui des connaissances. Le débat n’est pas neuf, mais le ton et la fermeté de cet appel sont frappants. Les signataires, rejoints aussitôt par plusieurs centaines de médecins et de praticiens, n’hésitent pas à parler de « fake medecines » et de « charlatans ».
Dans leur collimateur : homéopathie, acupuncture, mésothérapie. Ils préconisent d’interdire carrément l’usage de leur titre de médecin à ceux qui les pratiquent, de ne plus reconnaître officiellement ni l’enseignement ni les diplômes de ces disciplines, et de dérembourser ces soins parce qu’ils seraient inefficaces, voire dangereux. Ils demandent de promouvoir l’information sur leurs effets, qu’ils considèrent soit nuls soit nocifs – le plus souvent nocifs parce que nuls, légitimant des espoirs chimériques, retardant des diagnostics indispensables et des traitements scientifiquement fondés.
Il ne faut pas oublier que 40 % des patients français recourent à des traitements alternatifs, que leur présence s’accroit dans le milieu hospitalier, que leur prise en charge est assurée par la sécurité sociale. Pour les signataires de cet appel, c’est justement cela qui est scandaleux, qu’il faut dénoncer et combattre. Au motif, une fois encore, que ces méthodes et leurs résultats n’étant ni évalués ni probants, leur usage équivaut à du temps et de l’argent perdus, sans oublier une forme d’obscurantisme outrageusement légitimé. La seule médecine efficace serait donc celle dont les résultats peuvent être testés, vérifiés expérimentalement. Elle serait scientifique ou rien.
Dans un monde idéal, ce serait vrai. Le soin scientifique serait indiscutable si les décisions humaines n’étaient régies que par la raison et l’objectivité. Mais ce n’est pas ainsi que les hommes vivent. Et encore moins qu’ils se soignent. Nos craintes et espérances quotidiennes sont régies également par la représentation que nous avons du monde. Or la science inspire désormais plus de crainte que de confiance. Longtemps, on attendit de ses progrès des effets salutaires, et rien d’autre. Mais on découvrit au XXe siècle, avec la bombe atomique, ses capacités destructrices. Au XXIe siècle, les effets des technosciences sur le climat, l’alimentation, la qualité de vie se révèlent porteurs de catastrophes possibles. Dès lors, à tort ou à raison, la « médecine scientifique » pâtit inévitablement de cette défiance. Elle se trouve concurrencée, dans l’imaginaire quotidien, par la « nature », prétendue bonne, maternelle et sage, et par les savoirs ancestraux, supposés fiables, à tout le moins incapables de nuire.
Toutefois, il serait encore trop simple de penser que seules nos représentations expliquent l’actuelle défiance, que seules notre crédulité et notre irrationalité nous détournent peu à peu de la vraie médecine. Car la médecine scientifique porte sa propre part de responsabilité dans le paysage actuel. A force d’être scientifique, précisément, elle a tendance à oublier combien « le premier médicament, c’est le médecin », selon la formule rendue célèbre par Michaël Balint.
Faute de temps, faute d’écoute, à force d’examiner des organes plutôt que des organismes, de traiter des syndromes plutôt que de guérir des hommes, la pratique médicale se trouve atteinte de déshumanisation chronique. Et il n’y a aucun motif d’être doux avec cette pathologie qui affecte aussi bien la médecine libérale qu’hospitalière. La faute n’en incombe pas toujours aux médecins, qui n’ont pas changé, pour la plupart, mais au règne croissant de l’objectivation, qui transforme tout cas en résultats d’examen. Les données chiffrées sont une exigence scientifique légitime, mais elles ne doivent pas conduire à écarter le sens des paroles individualisées, l’existence des relations humaines.
En fait, derrière le débat « vraie médecine » contre « fausses médecines », plus de questions se profilent qu’on ne le voit d’abord. Il se pourrait qu’il indique un symptôme majeur de la crise contemporaine de la pratique médicale. Décider si la médecine est une science ou un art est une question qui traverse les siècles. Oublier qu’elle doit être les deux est un trait du nôtre.




