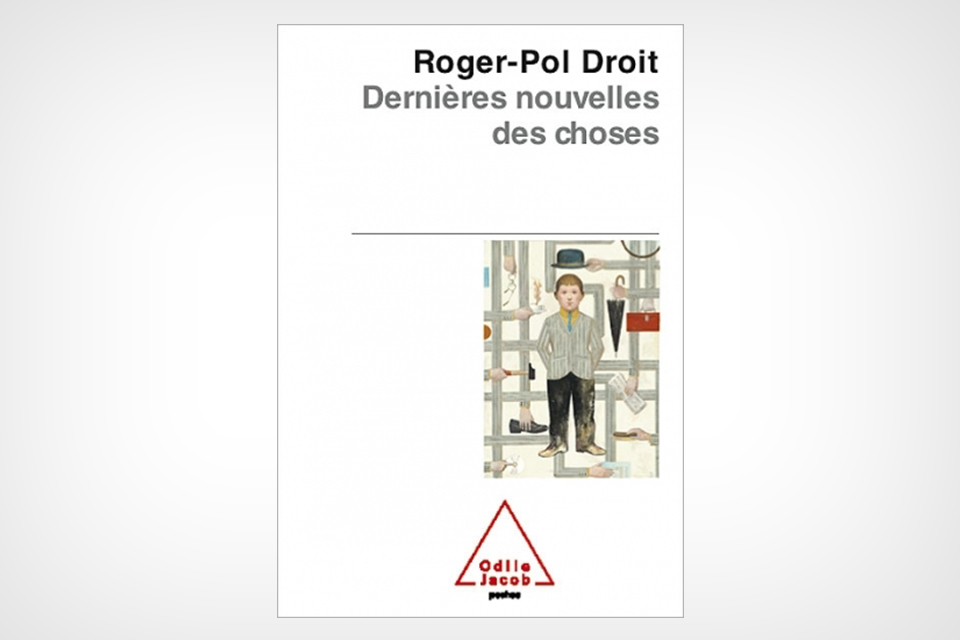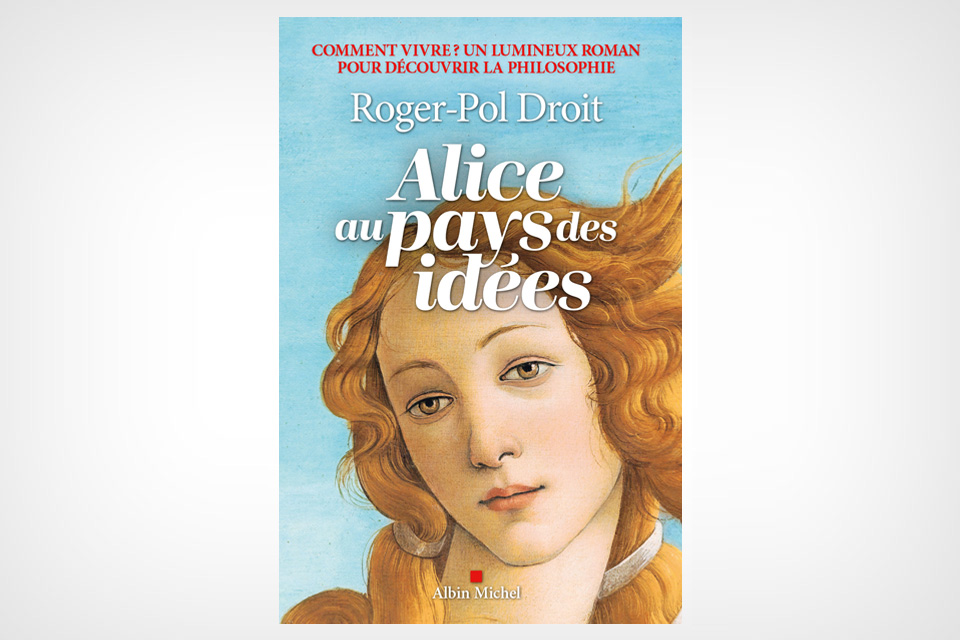Dans le fond, l’existence des objets est une grande énigme. Je n’ai jamais cessé de me demander ce qu’ils disent, dans cette étrange langue muette qui est la leur. Alors, pendant toute une année, j’ai tenté l’expérience de noter ce que j’observais.
Présentation de l’éditeur
Avez-vous déjà remarqué qu’un trousseau de clés ou un réverbère peuvent parler d’amour ? Saviez-vous que le lave-linge enseigne la migration des âmes, et le chariot de supermarché la confusion des sentiments ? Avez-vous jamais entrevu la métaphysique de la poubelle, la sagesse du parapluie, la révolution de l’aspirateur ? Regardez autour de vous. Il n’y a pas que les êtres humains dans la vie ! Faites l’expérience philosophique des choses ordinaires. Découvrez qu’elles sont capables d’étonner, d’affoler, d’apaiser. De l’attention, un certain humour, un rien de folie vous indiqueront un chemin pour voir les choses autrement.
Dernières nouvelles des choses
Odile Jacob, 2003
Réédition Poche Odile Jacob, 2005
9 €
Acheter ce livre sur :
– Amazon
– Fnac
Extrait
Il s’avance vers moi, tend la main. Il dit : « Alors, comment vont les choses ? » Je réponds machinalement : « Ca va, oui, tout va bien… et vous ? » Il fait un geste évasif. D’autres personnes lui font signe, il doit les rejoindre. Je le connais juste de vue. Chez des amis, je le croise parfois, dans des fêtes comme ce soir. Je ne sais pas de qui il s’agit.
« Comment vont les choses ? » Qu’a-t-il voulu dire ? La phrase, quelques instants après, me paraît bizarre. J’imagine qu’il veut demander des nouvelles. Pourtant, il ne dit pas : « Comment allez-vous ? ». Il ne dit pas : « Comment ça va ? ». Il ne dit pas : « Qu’est-ce que vous faites en ce moment ? ». Il ne dit pas : « Comment vont vos affaires ? ». Il ne dit pas : « Comment va votre famille ? ». Il dit, j’en suis sûr, je l’entends encore : « Comment vont les choses ? »
Quelles choses ? Comment vont quelles choses ? Toutes les choses ? Les choses en général ? Seulement certaines ? Mes choses à moi ? Lesquelles ? Ca veut dire quoi ? Je ferais mieux de laisser tomber. Il veut juste dire bonjour. Inutile de se préoccuper de ça. Changeons de chapitre.
Non, je n’y arrive pas. Cette phrase revient. « Comment vont les choses ? », encore et encore. Je reprends un verre de vin rouge, je parle à quelques personnes. Je vais embrasser une amie que je n’ai plus revue depuis longtemps. J’essaie de mettre cette phrase à l’écart. En vain. Question collante. J’ai beau vouloir la jeter, elle reste. Elle s’incruste. La voilà qui commence à vriller lentement l’intérieur de ma tête. Je résiste comme je peux, j’essaie de penser à d’autres phrases. Mais ça se propage, comme un éclat, une fissure, ça insiste, ça s’irise.
« Comment vont les choses ? » Oui, les choses, bien sûr, les choses… mais que sont-elles ? Non, je ne sais pas comment elles vont. D’ailleurs, ont-elles une vie à elles ? Quel genre de vie ? Quel genre de santé ? Ca suffit ! Les choses ne vont ni bien ni mal. Elles ne vont d’aucune façon. Rien à déclarer. Rien à voir, circulez. Les choses sont là, un point c’est tout. Ou bien elles sont absentes, un point c’est tout. Elles n’ont ni santé ni maladie. Ni grandeur ni décadence, ni vie ni mort, ni honneur ni indignité. Ce sont seulement des trucs, des machins, des choses quoi. Cette question est insensée.
Pourtant, le temps passe et la question insiste. Elle se divise, se multiplie. J’ai l’impression, par moment, d’entrevoir un fond opaque, une zone inconnue de silence interne. Vous me demandez comment vont les choses, et moi je reste coi. Je ne sais pas comment elles vont. C’est normal ? Est-ce que nous nous occupons de ça, d’habitude ? Est-ce que nous cherchons à savoir comment vont les choses ? Est-ce que nous avons raison ou tort de ne pas nous en occuper ? Est-ce qu’il ne faudrait pas faire un effort ? C’est insensé. Pourtant ça insiste. Je n’arrive plus à écouter ce qu’on me dit, je ne parviens plus à parler. Cette question idiote n’arrête pas de me tourner dans la tête. Pas moyen de penser à autre chose.
BolTard dans la ville,
une nuit au début de l’automne
Je ne sais même plus quelle heure il est. La nuit est tombée depuis longtemps après une journée interminable. Beaucoup trop de paroles. Pourquoi parlons-nous tant ? Et il commence à faire frais. Avant goût de nuit d’automne. À la campagne, la nuit doit être très noire, on doit marcher sans voir le chemin. L’envie me vient d’une soupe à l’oignon, gratinée, brûlante. Une survivance. Vestige paysan devenu curiosité pour touristes. Je sais encore où aller, heureusement.
Se pose devant moi un gros bol, fumant, bouillonnant encore. Odorant, croûté. Là brun, presque noir, ici tirant encore vers le jaune pâle. Mais ce qui arrive n’est pas la soupe. Plus que les vapeurs, la buée et le souffle du four, ce qui arrive, c’est le bol. Massif, comme du fond des âges. De l’enfance et d’au-delà. Préhistorique. Chose concave, préservant le liquide, l’empêchant de fuir. Forme qui rassure. D’emblée familière et fidèle.
J’en oublie presque pourquoi je suis là. Voilà un objet premier, originaire. Cette chose marque l’émergence de l’humain. Les grands singes ont des gourdins, des pierres, quelques équivalents d’armes et d’outils. Pas de bols. Avec l’humain seul naissent écuelles, calebasses, jattes, bols.
Le bol inaugure la fonction récipient. Fondamentalement, elle rassure. Dans la totalité des flux, le récipient vient interrompre l’écoulement sans fin. Il préserve de la dispersion. Il arrête l’effusion. Suspend l’épanchement. Le liquide, inéluctablement voué à la fuite et à la perte, est retenu. Mieux que par les mains. Durablement. Sans effort.
Le bol permet une régulation de l’entropie naturelle. Une scansion dans ce qui passe sans fin. Il s’interpose dans le passage universel où, sinon, « tout s’écoule », comme savait Héraclite. Intervention maîtrisée, réversible. Point essentiel. Si le bol, en un sens, imite le rocher creux ou l’ornière, la minime cavité naturelle, il ne se contente pas de la copier. Il n’est pas statique. Se renverse, se vide. Se porte en bouche, avec les mains. S’emporte. Pas besoin de se dire cela pour éprouver la confiance que le bol engendre, animale et chaude. Corporelle, immédiatement perceptible. Le bol, à peu de choses près, a toujours la taille des mains, et le volume de l’estomac. Quand le Bardo Thodol, le Livre des morts tibétains, donne pour mesure d’une prière ou d’un rite « le temps d’un repas », il s’agit de cela : une durée stomacale, une bolée temporelle.
À disposition, à la mesure du corps, caverne ouverte, réceptacle tiède, le bol est évidemment le plus maternel et le plus rassurant des objets. Ce n’est pas sans raison que les moines de la communauté du Bouddha avaient tout abandonné sauf un bol à aumône. Il leur servait en quelque sorte de maison. D’autant plus remarquable qu’il paraît, contrairement à la puissance archaïque du maternel, dépourvu de menace. Sein purement concave, purement suave, antérieur apparemment à tout conflit, tout clivage. C’est pourquoi il y a dans le bol quelque chose d’immuable. L’histoire peut l’affubler de matières diverses – bols de bois ou de terre cuite, de grès vernissé ou de plastique, en céramique avec le prénom de la petite, translucide, en alu dans les courses de montagne, en faïence à la ferme – tous ont un air de famille : accueillant et placide.
C’est une chose très puissante à force d’être faible. Voilà pourquoi c’est une chose du terme, du commencement ou de la fin. Bol de l’enfant, bol du vieillard. Bol du matin (thé, céréales, lait, café, porridge), bol du soir (soupe, bouillon, tisane), cette chose est présente quand la vie commence à s’activer, quand elle décline et s’alanguit. Entre temps, occupé de vivre, vous rangez et oubliez.
Ce soir-là, je m’endors en rêvant de livres qui seraient comme des bols de mots.
TromboneDans un train,
en fin d’après-midi
C’est en cherchant un stylo au fond de ma serviette que je l’attrape par hasard dans une rainure du cuir. Il a dû glisser d’un dossier. Ou il s’est peut-être coincé, depuis longtemps, dans cet interstice où se fourrent toujours un peu de poussière, un bout de papier plié, un élastique. C’est un trombone intact, métallique et mince, sec, propre.
Cette chose inspire la sympathie. En tout cas de mon point de vue. Vous avez peut-être un avis différent. La sympathie suscitée par les trombones n’est pas universelle. Ce n’est que mon point de vue, je le répète. Mais quel autre point de vue que le mien pourrais-je donc avoir sur le monde ? Vous savez, vous, l’effet que ça fait d’être une araignée ? Une girafe ? Un porte-manteau ? Votre voisin ? Vous croyez, peut-être. En fait, vous ne savez pas. Pas du tout. Moi non plus. Alors, je peux bien éprouver de la sympathie pour les trombones sans qu’on en fasse toute une histoire.
Quoi de sympathique dans le trombone ? L’astucieuse pliure ? Le côté lisse, léger, métal propre ? Le petit bout triangulaire où l’on peut jouer à mettre juste l’extrémité de la langue ? L’envie de le désarticuler ? Le fait que ce soit une chose petite, sans grade ? Dans la famille « choses discrètes », je demande le trombone. C’est un cousin de l’épingle, mais beaucoup plus doux. Aucun risque de se piquer. Pas de trou dans les feuilles. Le trombone n’abîme rien. Il n’a ni la brutalité de l’agrafe, ni le caractère intrusif des coins et autres attaches.
Le trombone appartient à la catégorie des choses insignifiantes, habituellement laissées pour compte. C’est pour cela que je l’aime bien. On ne peut pas dire que ce soit un frimeur, le trombone ! Il ne fait rien pour attirer le regard. De fait, il ne l’attire jamais. Personne ne dira qu’il est carrément indispensable. Il rend des services, fait ce qu’on lui demande, dans la mesure de ses moyens, obstinément. Réglo. Pas génial, mais réglo.
Révélateur aussi, modestement toujours. Ce n’est pas toute époque ni toute société qui produit des trombones. Il faut, pour qu’il existe, des machines outils capables de travailler un type de fil métallique parfaitement uniforme, souple et résistant, il faut un univers de documents, de feuilles de papier à réunir, un monde de bureaux, de réunions, de dossiers, d’employés de bureau, d’accessoires de bureau, de fournitures de bureau. La naissance du trombone doit dater du début du XXe siècle. Sans doute son existence n’est-elle pas éternelle. Peut-être verra-t-on, un jour pas si lointain, le trombone s’effacer.
Avec la mort du trombone, nous aurons perdu une des figures d’Eros. Ce petit bout de métal qui relie les feuilles et les rassemble fait songer, à sa manière, à ce que Freud appelle Eros. Pas vraiment la sexualité, moins encore la jouissance. Plutôt la force qui agrège sans paralyser. La puissance qui empêche la dispersion. La vie qui résiste à l’entropie. À sa façon, métallique et modeste, le trombone fait tout cela. Il retient, comme le bol, quoique très différemment.
Je me souviens d’une émotion particulière. Je retrouve, il y a quelques temps, d’anciens dossiers, datant de ma jeunesse. Ils sont depuis de longues années à la campagne, dans une maison humide. Avec le temps, les trombones ont rouillé. Ils laissent même, quand je les défais, une marque brune et creuse sur les papiers, et sur mes doigts des grains rêches. Mais ils n’ont pas lâché prise. Ils ont tenu, à leur place, et rempli leur rôle, malgré les ans et la rouille.
Pour sa façon de faire ce qu’il y a à faire, sans forfanterie, sans rébellion (on ne peut imaginer une révolte de trombones), dans l’ombre, sans souci des complots ni des honneurs, anonyme et utile, ni héroïque ni téméraire, mais fidèle et sérieux, le trombone est une figure de l’éthique.
Avis
Les critiques [evene]par A.E.
Ces dernières nouvelles sont un véritable régal. On peut être un peu sceptique, au premier abord, face à l’entreprise de Roger-Pol Droit : nous donner des nouvelles des choses, et nous donner des nouvelles d’une humanité perdue, enfouie sous un amas d’objets dont elle ne sait que faire, n’était pas sans risque. On pouvait donc s’attendre à une « deuxième gorgée de bière » ou une énième « expérience philosophique ». Nous ne sommes pas déçus. Car ce livre est aisé à lire, facile à suivre et ne nécessite aucune formation universitaire. Encore une fois, Roger-Pol Droit mène à bien une entreprise périlleuse : rendre la philosophie accessible et rappeler au commun des mortels que la philosophie est là, tout le temps, dans notre trousseau de clés, dans le collier qu’on a offert à sa femme, dans notre rapport aux vêtements. « Un prémaché pour les incultes ? », pourraient nous rétorquer les intellectuels. Et bien non, absolument pas, car les philosophes, s’ils mettent leurs préjugés d’universitaires de côté, y verront aussi les réflexions fines d’un chercheur qui est certainement bien plus philosophe que les « fonctionnaires » sur lesquels s’apitoyait Merleau-Ponty : l’auteur s’inscrit bien dans une tradition de philosophes vivants, s’inspire de son expérience pour philosopher et rend par là même la philosophie plus dynamique. Il faut lire ce livre parce qu’il est aussi pertinent qu’évident, parce que, comme le disait encore Merleau-Ponty, « le philosophe se reconnaît en ceci qu’il a le goût de l’évidence et le sens de l’ambiguité »…
Les avis [des membres]
Avis de Sahkti : Dans un langage simple et attirant, R-P Droit explique que notre société est quelque peu perdue au milieu de ces besoins et objets dont nous n’avons que faire. Il est temps de rendre leur juste place aux choses, de placer l’esprit avant la matière. C’est de la philosophie de tous les jours, pas de théorie compliquée ou de jargon universitaire, c’est un livre destiné au grand public, pertinent et adapté à notre société. Droit se demande comment se portent les choses. Etrange à première vue, on a plus souvent l’habitude d’entendre « Comment va le monde? ». Or ce monde, il est aujourd’hui essentiellement composé de choses, d’objets. Ceux-ci existent-ils? Ont-ils une âme? Et si on se prenait à rêver qu’ils en ont une, quels propos pourrait-on leur prêter ? Je retrouve la démarche de Maurice Maeterlinck dans « L’oiseau bleu » et l’âme des objets, surprenante pour nous, êtres vivants, qui oublions de regarder les objets de tous les jours avec la considération qui devrait être la leur, au vu des services qu’ils nous rendent. En revenant à leur mission première (nous aider),on ressuscite des histoires, on recrée cette complicité entre l’humanité et les objets qu’elle a crées pour sa survie. Survie devenue vie puis bien-être. C’est sans doute là que les choses ont commencé à coincer. Reléguées au rang de vulgaires objets, nous n’en avons plus saisi la véritable richesse, tout est devenu banal et nous de grands blasés ne nous émerveillant plus de rien.
Libération
Trombone et billet de train, table, voiture, chasse-mouches, portable… Les choses, loin de peupler innocemment l’existence, la colonisent suivant un mouvement pullulant irrésistible et terrifiant : «Les choses contrôlent tout, sans en avoir l’air. Absolument tout. Nos moindres faits et gestes sont conditionnés par des foules de choses, muettes, apparemment dociles. (…) Ce règne des choses est sans failles, sans alternative. Il n’y a pas de dehors, pas d’ailleurs.» Il faut donc les prendre au sérieux. Les pérégrinations de l’auteur au pays des objets quotidiens composent un tonique voyage philosophique dont il tire les conclusions à chaque étape : si «notre attitude envers les choses indique notre rapport à nous-mêmes», il faut alors les aimer comme soi-même et envisager sérieusement une «Déclaration universelle des droits de la chose et de l’objet». Pour le chroniqueur du Monde, chercheur au CNRS et écrivain, aller par la plume au fond des choses signifie s’enfoncer au plus profond de leur nuit, dans «cette contrée hors du langage, de la pensée, du domaine du vrai et du faux, hors de la vie».
Jonathan Chauveau
« A l’âge de 33 ans, le cancer a bouleversé ma vie de femme et de comédienne. Comment renoncer à l’insouciance de la jeunesse et accepter brutalement l’idée de sa propre mort ? Comment se construire avec cette maladie et en même temps garder l’espoir ? » J’avais dans ma tête cette petite phrase de Francis Ponge : « Après une certaine crise que j’ai traversée, il me fallait (parce que je suis pas homme à me laisser abattre) retrouver la parole, fonder mon dictionnaire. J’ai choisi alors le parti pris des choses. »
Au cours de ma convalescence, un livre « Dernières nouvelles des choses » de Roger Pol Droit fut une révélation. De cette rencontre littéraire puis humaine, j’ai découvert un autre regard posé sur les « choses » ; celles qui nous entourent et qui prennent vie si l’on veut bien prendre le temps de s’arrêter et de les regarder.
J’ai eu envie à mon tour de poser mon regard sur les « choses » de cette nouvelle vie, de cette maladie, et d’offrir une réponse pleine d’espoir face à une épreuve très dure. Et puis cette écriture naturellement a pris une dimension théâtrale, parce que je suis comédienne et que, pour moi, le plateau est mon lieu d’expression. J’ai demandé alors à Jean-Marie Broucaret de m’aider à réaliser ce projet un peu à part. »
Laurence Pollet-Villard
Traduction
- en allemand,
- en anglais,
- en coréen,
- en danois,
- en finnois,
- en chinois (Taïwan),
- en polonais,
- en chinois (Chine Populaire),
- en néerlandais)