Les sceptiques sont subversifs
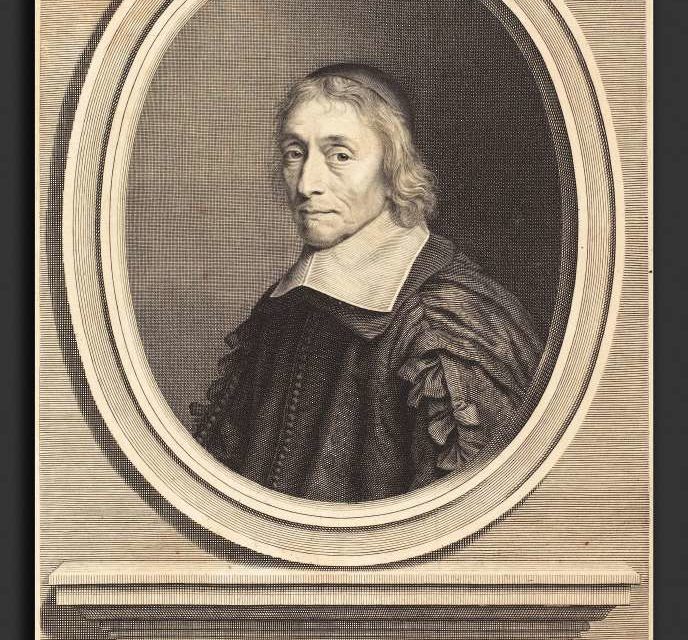
Pendant qu’on brûlait en Europe sorcières et hérétiques, Descartes fondait en raison la vérité. Quel rapport ? Question gênante, souvent esquivée. Entre les maîtres du rationalisme, instaurant des certitudes premières, et les bûchers où grésillèrent Giordano Bruno et d’autres, soupçonnés d’athéisme, quelques historiens, comme Carlo Ginzburg, ont commencé à montrer l’existence de liens multiples. Les philosophes, pour creuser ces questions, doivent changer de regard. Au lieu de voir les querelles doctrinales comme des jeux théoriques, il faut y chercher des batailles cachées où s’affrontent pouvoirs et subversions, forces de l’ordre et du désordre.
C’est ce que fait André Pessel ; dans cet essai posthume. Ce philosophe – spécialiste de Spinoza, enseignant à l’Ecole normale supérieure, inspecteur général de philosophie – est mort le 18 décembre 2019. On comprend, en le lisant, pourquoi le scepticisme n’est pas une école parmi d’autres. Il constitue plutôt une manière spécifique et radicale de désorganiser savoirs et pouvoirs en place. Soutenir qu’on ne peut atteindre aucune vérité détraque la domination religieuse et la domination rationnelle. Des travaux classiques l’ont déjà souligné, comme celui, ancien, de René Pintard sur le libertinage érudit (1943) ou ceux de Richard Popkin sur l’histoire du scepticisme (1995 et 2019). Mais André Pessel ajoute ce point décisif : c’est leur conception particulière du sujet – multiple, fluctuant, aléatoire… – qui donne aux sceptiques de l’Âge classique leur force de subversion la plus grande et la moins aperçue.
Ainsi, quand Montaigne écrit dans l’Apologie de Raymond Sebon : « Il n’est aucune constante existence ni de notre être ni des objets », on aurait tort de n’y voir qu’une répétition innocente de l’idée que le monde est un « branloir pérenne », un changement perpétuel. Car si notre conscience est à éclipse, si notre moi est toujours un autre, si notre être se révèle constamment en devenir, alors c’est toute la question de l’identité qui change de perspective. Et les conséquences ne sont pas seulement philosophiques, mais aussi religieuses et politiques.
« Le scepticisme fait bouger les lignes, il brouille les pistes » lit-on dans dans l’introduction. La phrase peut s’appliquer à l’ouvrage lui-même, qui brouille effectivement les pistes. Au premier regard, sous un titre austère et opaque – Les versions du sujet –, on ne voit qu’une série d’études éruditissimes sur des auteurs plutôt oubliés, comme Jean-Pierre Camus, évêque de Belley (1584-1654), le philosophe La Mothe Le Vayer (1588-1672) ou le bibliothécaire Gabriel Naudé (1600-1653)
L’erreur serait d’en rester là. Car la démonstration proposée est importante, et finalement très actuelle. Elle fait voir que le scepticisme est bien plus que cette attitude intellectuelle qui, depuis les Grecs, consiste à contester que nous puissions atteindre des vérités ou même à nier leur existence. On découvre, avec Pessel, une autre face, celle de la subversion. En déployant une conception du sujet comme « multiple », non unifié, toujours situé quelque part de manière précaire, les sceptiques des XVIe et XVIIe siècles perturbent le fondement des argumentations et des connaissances, mais aussi celui des identités et des assignations à résidence.
Le découvrir aujourd’hui est d’autant plus utile que les dogmatismes de toutes natures se réveillent, et risquent d’avoir de beaux jours devant eux. Avec les doutes, les sceptiques fabriquent des armes. Elles peuvent encore servir.
LES VERSIONS DU SUJET
d’André Pessel
Klincksieck, « Critique de la politique », 198 p., 23,50 €





