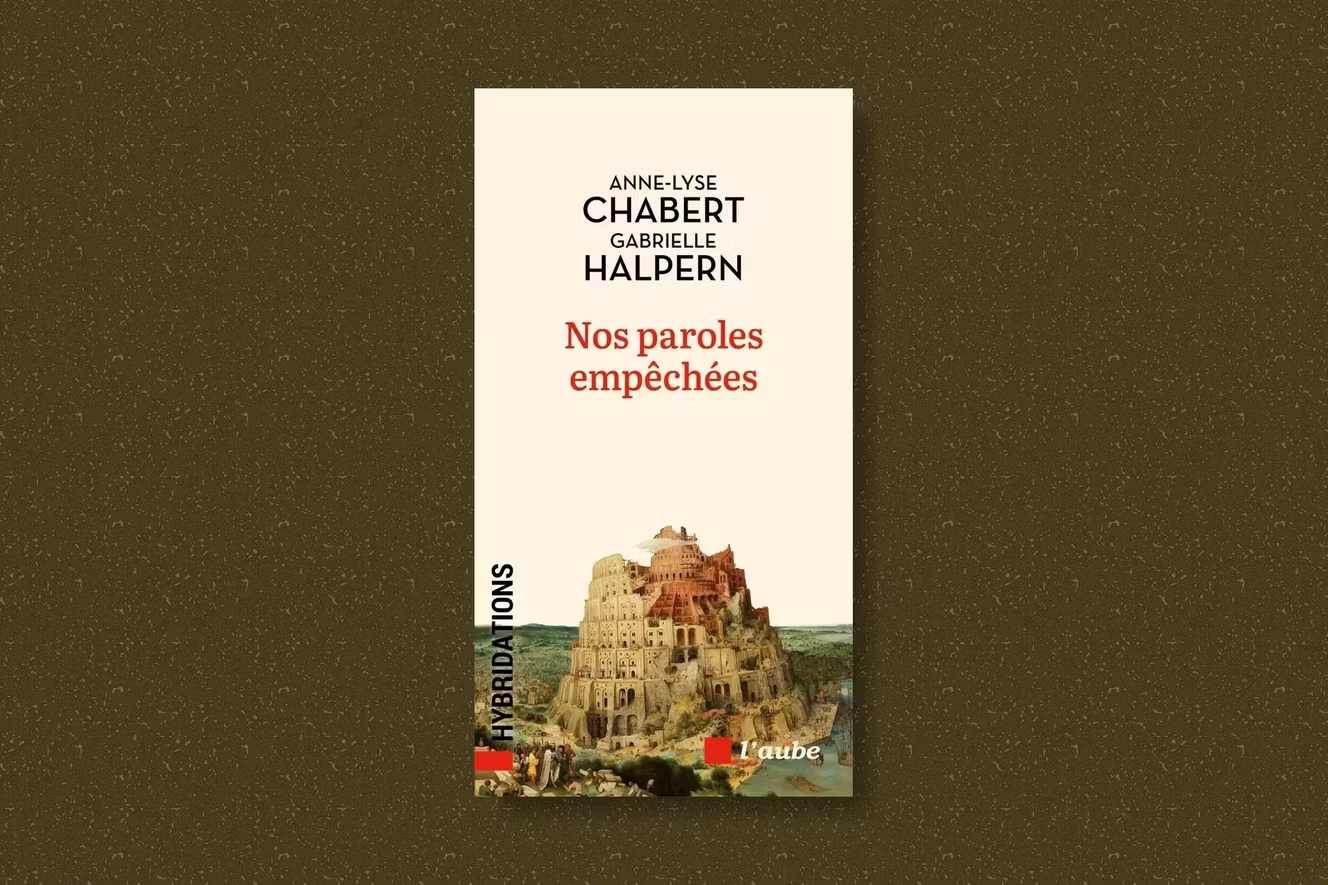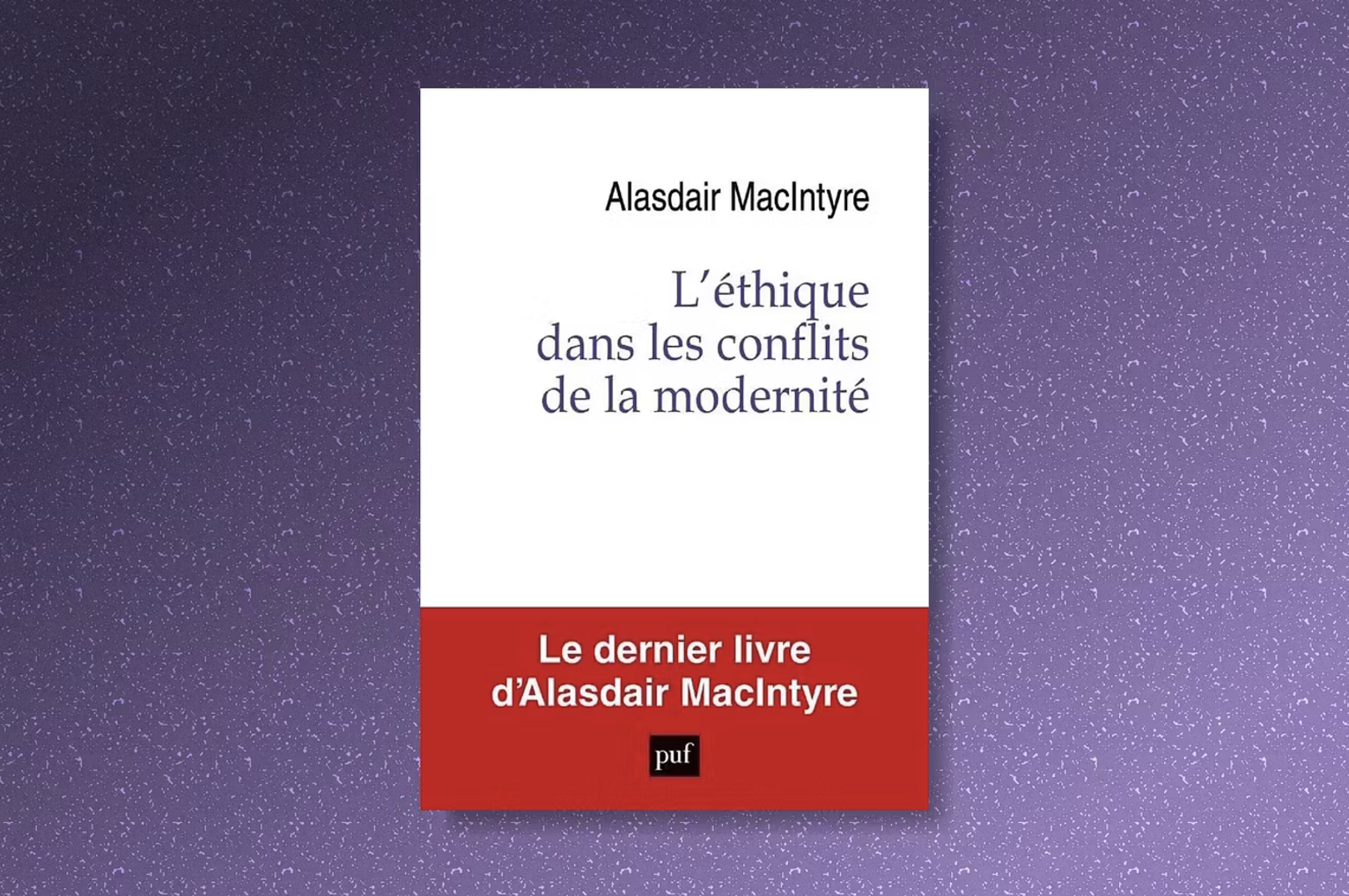Et si « ralentir » devenait le maître-mot de notre existence ? Si nous commencions à décélérer, ne plus courir à perdre haleine, toujours plus vite et plus longuement ? Si nous retrouvions le poids des heures, la saveur des jours, en résistant à l’injonction des performances et des chronomètres, de la ponctualité ?
Ce serait un changement d’époque, et de monde. Car les Temps Modernes, bien avant le film de Chaplin, s’ouvrent avec l’installation des horloges au cœur des villages, des montres au fond des goussets, bientôt des pointeuses et des cadences au centre du travail. Ensuite, le rythme s’est intensifié, aiguillonné par l’obsession de la vitesse et du rendement. « Mieux », désormais, signifie « plus vite ». En tous domaines – pour produire, pour voyager, pour calculer et prévoir… – la promptitude est devenue souveraine. Hors de l’accélération, point de salut.
Il y a longtemps que cet accroissement général du tempo a été mis en lumière. Marx soulignait déjà combien il est essentiel au capitalisme. Plus près de nous, Foucault a éclairé combien le contrôle serré des emplois du temps accompagne la naissance de la discipline qui dresse les corps. Paul Virilio a fait de la vitesse le critère majeur de la guerre comme de la domination politique et technique. Récemment, Barbara Stiegler a montré que le néolibéralisme s’accompagne d’une incitation constante à s’adapter à cette « accélération », dont le sociologue et philosophe allemand Hartmut Rosa a fait le centre d’une réflexion aujourd’hui décisive. Ce ne sont, bien sûr, que quelques repères, parmi bien d’autres.
La nouveauté, c’est qu’un revirement s’amorce. De plusieurs côtés s’élaborent des critiques inédites de cette course sans fin. Les méfaits du temps qui manque – productivité sans frein, hâte sans limite, angoisse d’être en retard – suscitent désormais des résistances. Des décrochages se mettent en place, slow food, lâcher prise et silence immobile. Voilà qu’on revient sur l’histoire et la place des « hommes lents », voilà qu’on fait l’éloge du retard et de sa fécondité.
L’historien Laurent Vidal, spécialiste du Brésil, professeur à l’Université de la Rochelle, consacre un essai à la fois alerte et savant à la mise en place de la rapidité moderne et à l’exclusion corrélative de la lenteur ancienne. Il décrit ce vaste tournant en voyageant dans les archives, de la fin du Moyen-Âge à l’ère industrielle, attentif aux points de rupture et aux mots qui les signalent. Le mot « lenteur » n’apparaît en français avec son sens actuel qu’en 1355. Le latin lentus ne concerne pas seulement un rapport au temps, mais indique aussi ce qui est mou, flexible. L’essentiel, c’est le basculement du lent du côté du négatif, du mal, du vice.
En effet, à mesure que les Modernes, en Europe, se constituent en travailleurs efficaces parce que prompts, à mesure que valeur et vaillance consistent uniquement à tenir la cadence, on juge peu à peu les Anciens – mais aussi les sauvages, les barbares, tous ceux du dehors… – comme apathiques, indolents, donc paresseux. Tous sont inaptes par lenteur. Les Indiens, tels que les perçoivent les conquistadors, « jamais ne se hâtent ». Ils préfère leur hamac aux tâches constructives. Les Africains sont perçus par les colons blancs comme inattentifs. Ces comportements dénotent une volonté mauvaise, une nature inférieure, voire dangereuse.
Le fil rouge de la modernité, ce serait donc la guerre faite aux flâneurs, aux rétifs à l’accélération, à tous ceux qui ne suivent pas le rythme. Incapables de s’adapter, donc inefficaces, obstacles au progrès, ils deviennent la lie de l’humanité. Mis à l’écart, au rebut, les lents sont inutiles, donc invisibles.
« Tout rapport de force est un rapport de temps » note finement la philosophe et psychanalyste Hélène L’Heuillet, maître de conférences à la Sorbonne, dans Eloge du retard. Sa méditation, conduite et formulée avec élégance, s’inscrit elle aussi dans la perspective d’une critique de la société où triomphent le fluide, le flexible et l’urgent. Mais elle déplace les axes de la réflexion. Car le plus important n’est pas, pour Hélène L’Heuillet, d’agir lentement plutôt que rapidement. C’est avant tout de « prendre le temps » qu’il est question, de le ressaisir en se le réappropriant. Ne pas respecter les délais, ne pas tenir les cadences, assumer donc d’être « en retard », telle serait la clé. Mais de quoi ?
De la vie, tout simplement. Dans une époque où le temps manque partout – à tel point que cette absence engendre insomnie, fatigue, ennui, mélancolie ou burn out… – le retard devient en quelque sorte réparateur. Il fournit une temporalité de rattrapage, rouvre le jeu, rend aux heures disponibilité, présence et densité perdues. Le retard serait finalement l’accès au temps retrouvé, suggère cet essai original, souvent subtil. Et parfois paradoxal, puisqu’il conclut à la nécessité de « se hâter d’être en retard ».
Sans doute ne peut-on réfléchir sur le temps sans côtoyer des paradoxes. Celui d’aujourd’hui : l’urgence de ralentir. « Dépêche-toi d’aller moins vite » pourrait être sa maxime. Il suggère d’accélérer la décélération, de nous presser à ne pas nous presser. Façon de changer d’époque, ou de rester dans la même ?