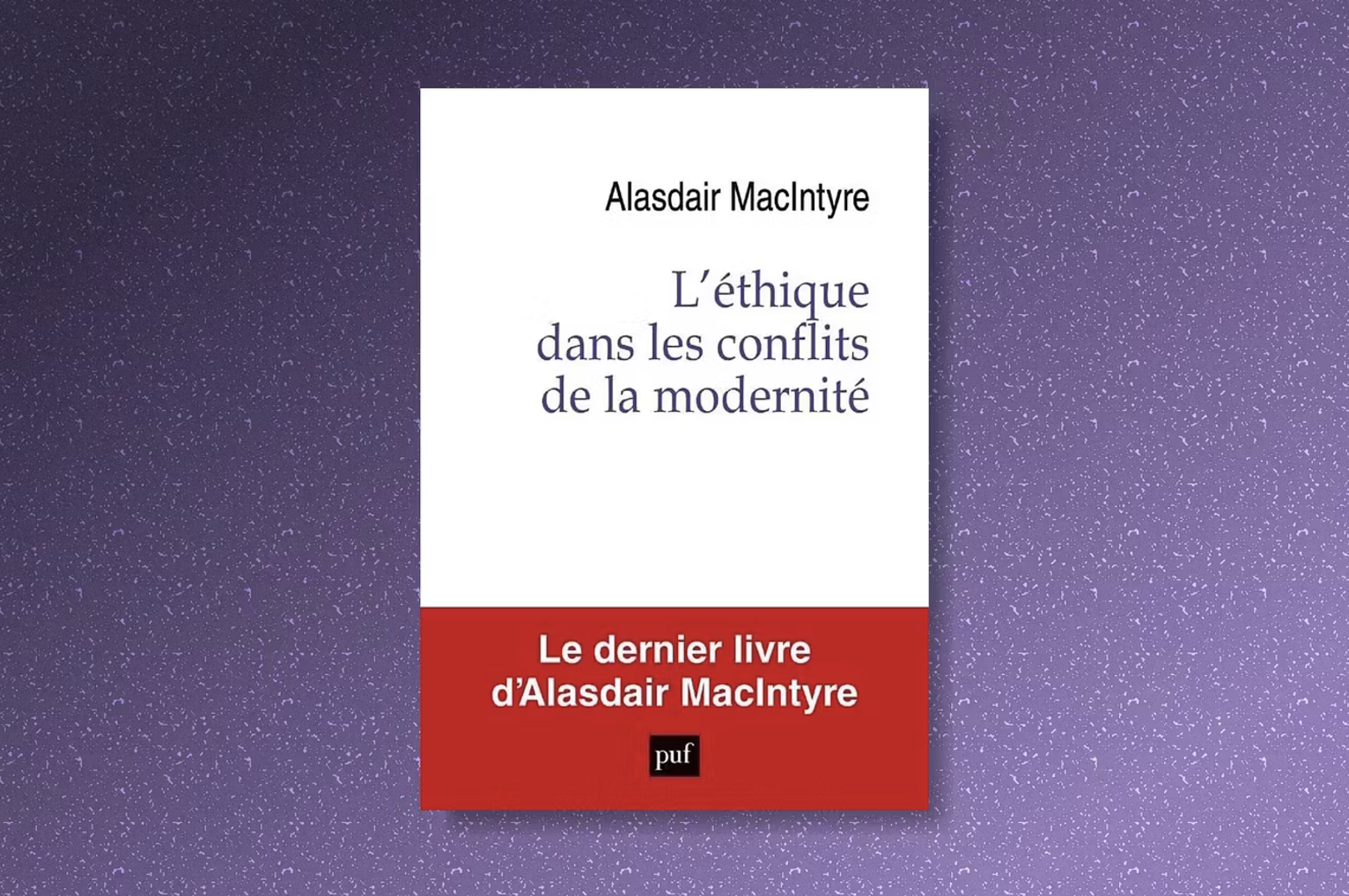Un siècle d’histoire méconnue et compliquée… Tel pourrait être le sous-titre de ce cours exceptionnel donné au Collège de France, en 2016, par l’écrivain Alain Mabanckou. Il y a une centaine d’années, dans la France sortant de la Grande Guerre, se juxtaposaient le « Y a bon ! » de Banania, infâme caricature paternaliste des tirailleurs sénégalais morts au front, et le premier congrès panafricain, tenu en même temps que le congrès de Versailles, à l’initiative du député du Sénégal Blaise Diagne. Aujourd’hui, le chemin parcouru est évidemment considérable, mais le décompte est loin d’être achevé. Quantité d’esquives et de pièges subsistent, qu’il faut décrire et lever, pas à pas, sans relâche, si l’on veut avancer et continuer à créer un autre monde. C’est à ce déminage et à cette ouverture d’horizon que contribuent ces huit leçons de haut vol.
Au commencement était l’infini mépris. Il niche dans le regard condescendant des colons, qui veulent parler au nom de gens jugés incapables de penser et de s’exprimer, tout comme ils auraient été incapables, au fil des siècles, de construire quoi que ce soit. Aimé Césaire sut exprimer avec une infinie justesse le prétendu néant qui définissait alors les Noirs : ils étaient ceux qui n’avaient « inventé ni la poudre ni la boussole, ceux qui n’avaient jamais su dompter la vapeur ni l’électricité, ceux qui n’avaient exploré ni la mer ni le ciel ». Vint ensuite le temps des déstabilisations : découvertes de Harlem et du jazz, premières créations politiques noires en Haïti, dénonciations de l’oppression par André Gide ou Albert Londres… Jusqu’au tournant marqué, en 1956, par la création de la revue Présence africaine et par le « Congrès des écrivains et artistes noirs », autour notamment de Senghor et de Césaire. Ce dernier rappelait cette évidence toujours à revivifier : « Aucune race ne possède le monopole de la beauté, de l’intelligence, de la force. »
Penseur attentif et fier
Dans ces leçons au Collège de France, qui furent un événement, Alain Mabanckou éclaire les lignes de force de l’épopée que constitue la création intellectuelle africaine de langue française. Il insiste notamment sur le rôle oublié des femmes artistes et écrivaines, suit le remplacement des colons blancs par les dictateurs noirs, qui fut décrit par Yambo Ouologuem, en 1968, dans Le Devoir de violence (Seuil). Il retrace les tensions, effervescences, explorations des auteurs de sa propre génération, jusqu’au génocide des Tutsi au Rwanda et aux enfants-soldats des guerres en cours. Avec précision, mais aussi avec fougue. Car ce n’est pas en historien que parle l’écrivain, mais en penseur attentif et fier, qui ne craint pas de choquer, d’où qu’ils soient, ceux qui croient toujours le monde trop simple et les contours du malheur trop vite fixés.
Car rien n’est moins figé que l’aventure d’écriture et de pensée de l’Afrique. Son visage s’invente à mesure – tout comme l’œuvre de cet auteur, forte aujourd’hui d’une douzaine de romans, d’une dizaine d’essais, de plusieurs recueils de poèmes, sans oublier quelques volumes d’images et disques d’expériences musicales. Alain Mabanckou a beau ne plus compter les honneurs et les prix, le poids de la notoriété ne l’empêche pas de frayer un chemin de liberté. Une phrase, prononcée à cette chaire de création artistique du Collège de France, le dit exactement : « Créer, c’est recomposer l’univers, lui donner (ou redonner) une géographie, une histoire, des langues. »