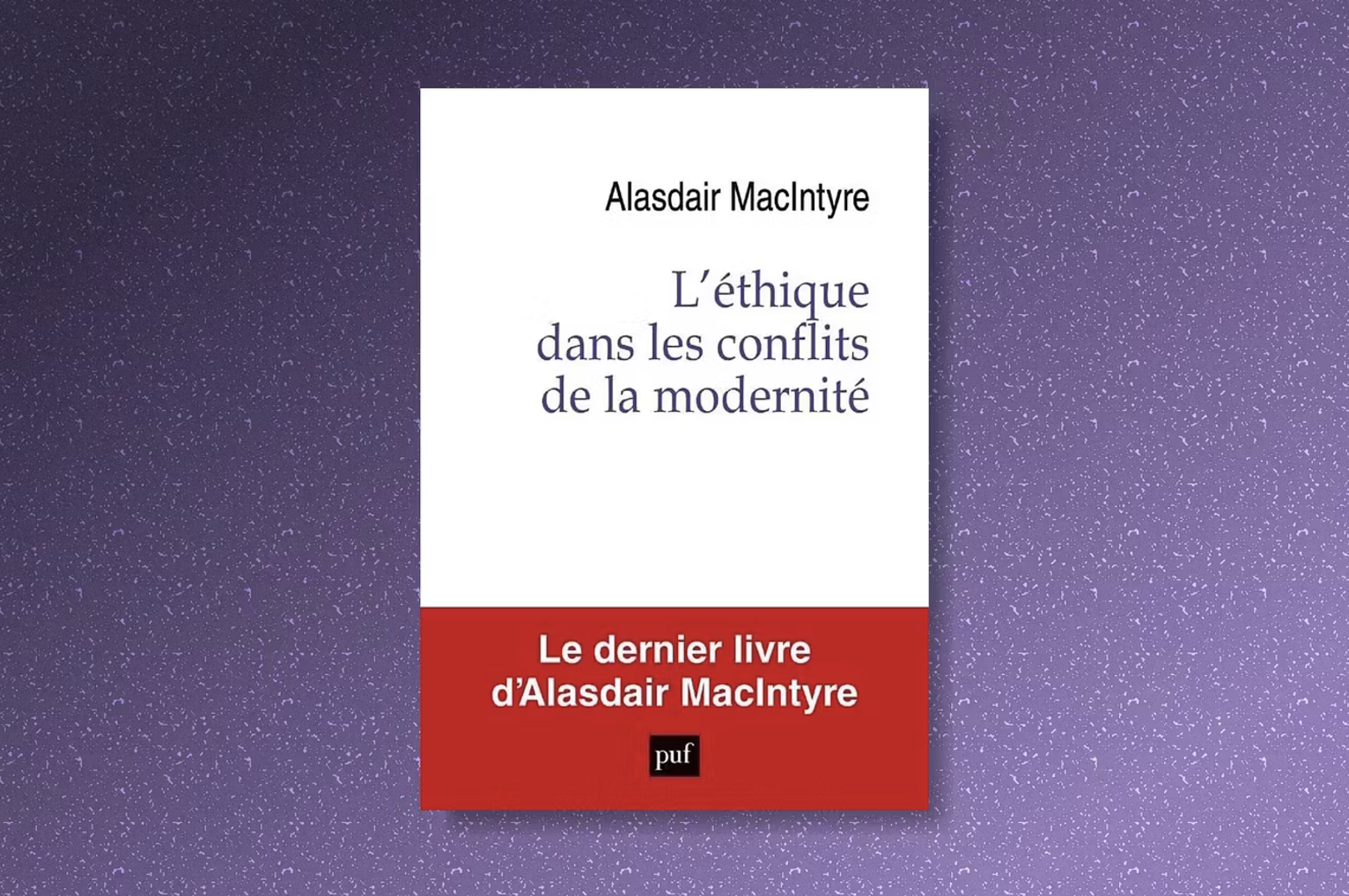Ne pas confondre John Gray et… John Gray. Le premier, américain, né en 1951, s’est fait connaître en publiant Les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus (Michel Lafon, 1997), suivi d’une série de best-sellers de la même veine. Le second, dont il est ici question, est un universitaire et journaliste britannique né en 1948. Il a enseigné la philosophie politique à l’université d’Oxford, à Harvard, à Yale et, jusqu’à sa retraite, en 2008, à la London School of Economics. Ses nombreux livres, où voisinent des études sur Friedrich Hayek, Isaiah Berlin, John Stuart Mill et Voltaire, lui ont certes valu estime et renommée. Mais ce qui l’a rendu célèbre, du moins au sein du public anglais cultivé, ce sont des prises de position radicales et provocantes contre les illusions « humanistes » de notre époque.
Sa bête noire : l’idée d’un progrès moral au fil de l’histoire. Son ennemi : l’humanisme, entendu comme cette croyance qu’il nous est possible de prendre notre destin en main, de construire un monde meilleur et délivrer l’humanité des maux qui l’accablent. Ces convictions sont fort répandues, et même fondatrices des civilisations modernes. John Gray n’y voit que funestes fantasmes, mirages dangereux. Certes, il reconnaît que les connaissances scientifiques deviennent chaque jour plus précises, et les techniques plus puissantes. Mais là s’arrête, à ses yeux, ce qu’on peut appeler « progrès ». L’humanité, elle, serait toujours la même : animale, immuable, immobile. C’est pourquoi les questions éthiques et métaphysiques se poseraient toujours semblablement, à chaque génération, sans aucun effet cumulatif des éventuelles réponses.
Tels baleines et babouins
Pire encore : l’histoire de l’humanité, selon John Gray, est dépourvue de sens. Nous nous racontons qu’elle en possède un, ou que nous sommes capables de lui en donner, alors qu’en fait nous ne serions pas plus maîtres du destin de notre espèce que ne le sont baleines et babouins. Incapables de nous raisonner vraiment, de changer effectivement, de construire réellement quoi que ce soit, les humains ne seraient que des primates rapaces. Leur probable extinction ne fera ni froid ni chaud à la nature. Telle est, en résumé, la rude leçon martelée par ce philosophe. Il se réclame notamment, ce qui ne surprend pas, du grand maître en désillusion que fut Schopenhauer.
Pourquoi ce titre, Chiens de paille ? Rien à voir avec le roman de Drieu la Rochelle (Gallimard, 1944), ni avec le film de Sam Peckinpah (1971) qui s’intitulent ainsi. Pour comprendre, il faut relire Laozi, Tao-Te-King, chapitre 5 : « Ciel et Terre n’ont pas de bonté : ils traitent les dix mille êtres comme chiens de paille. Les sages n’ont point de bonté : ils traitent les humains comme chiens de paille. » Et il faut préciser que ces « chiens de paille » – tout comme les « tigres en papier », mieux connus grâce à Mao Zedong – étaient des figurines fabriquées pour être brûlées au cours des rituels taoïstes. John Gray conclut que la nature ne se soucie aucunement de la disparition de l’espèce humaine, et qu’un esprit lucide doit en faire autant.
La lecture de cet essai est irritante comme une douche froide avec friction au gant de crin. Son évident mérite : secouer. Son défaut, non moins évident : inciter à la paralysie de toute action. Et, tandis que le penseur aboie, la caravane passe…