Les vraies urgences médicales, et les autres
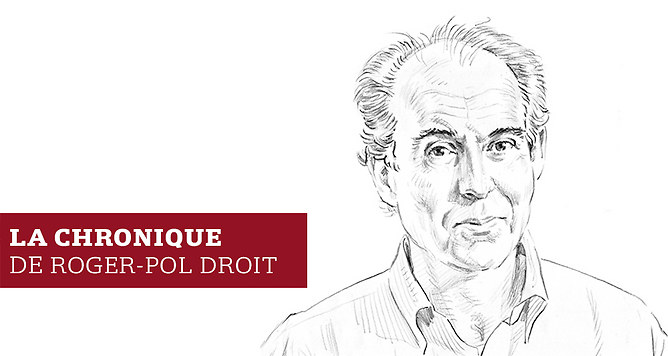
Fabien Clairefond pour Les Echos
Les « urgences » sont malades. Depuis des années, les médecins le soulignent, le personnel hospitalier l’affirme, les pouvoirs publics le savent. Mais rien ne change. Et même, tout empire. La mort de Naomi Musanga, cette jeune femme dont l’appel de détresse n’a pas été considéré comme il l’aurait dû l’être, vient de mettre en lumière, une fois de plus, la pathologie du système. Reste à savoir, pour tenter d’y remédier, en quoi consiste ce grand trouble, et d’où il provient. Au premier abord, ce n’est pas simple. Car le malaise est multifactoriel.
Les services d’urgence souffrent notamment d’une multitude d’appels parasites, fausses alertes, psychopathes et mauvais plaisants. Par ailleurs, il n’existe pas de plateforme unique, et la pluralité des numéros d’appel (le 15, le 18, le 112) crée des retards. Les centres hospitaliers voient aussi affluer, pêle-mêle et en grand nombre, des demandes de diagnostics et de traitements pour des maux bénins, parfois chroniques, qui n’ont, de fait, aucun caractère d’urgence vitale. Ces dernières sont presque toujours prises en charge vite et bien, mais les autres attendent – et parfois si longuement que des violences, verbales ou physiques, s’ensuivent. Incivilités, alcools et drogues s’ajoutent aux exaspérations et aux angoisses.
Les syndicats font état de 15 infirmiers agressés chaque jour. D’autre part, les effectifs demeurant insuffisants, les emplois du temps se compliquent et s’allongent, les fatigues s’accroissent. Enfin, pour ne rien arranger, la grande complexité des organisations administratives accroît la pesanteur du système et restreint les possibilités de réforme. Ajoutons que cette liste de causes déjà longue est loin d’être exhaustive. A l’arrière-plan de l’encombrement des services d’urgence, on ne saurait oublier ni les déserts médicaux ni la pauvreté.
Est-ce à dire qu’il faudrait se résigner ? Considérer la situation actuelle comme une fatalité ? Se contenter de petits pansements ? Ce serait déraisonnable et dommageable. Pourtant, il ne peut être question de bricoler seulement des aménagements pratiques. Ils sont indispensables, mais ne prennent sens que sur fond d’analyses globales. La première concerne les liens entre acte médical et temporalité.
Cet axe de réflexion est crucial : la médecine, par définition, est une course contre la montre et la mort. Toute son activité, depuis les premiers médecins – égyptiens, assyriens, grecs, chinois, indiens… – jusqu’à nos blocs opératoires est commandée par la temporalité. C’est vrai de la croissance et du vieillissement, de l’évolution des maladies et bien sûr des urgences proprement dites. Accidents, blessures, crises aiguës retenaient déjà l’attention d’Hippocrate. De champs de bataille en incidents domestiques, de malaises inopinés en affections foudroyantes, pouvoir soigner vite, sans se tromper, est une exigence perpétuelle. Au fil des siècles, les mêmes points se discernent : il faut que l’information circule rapidement, que les patients soient transportables ou accessibles en temps utile, que diagnostics et soins gagnent le mal de vitesse.
Sur ce point, il est clair qu’une confusion s’est installée entre services d’urgence et médecine gratuite pour tous. L’habitude s’est prise de venir aux « urgences » quand le petit a un rhume ou que sa sœur a de la fièvre. Avec une migraine, une toux ou une douleur à l’épaule, chacun va se présenter tranquillement aux urgences. C’est évidemment un grand mérite de notre système hospitalier de garantir examens médicaux et soins à quiconque se présente. Mais la distinction entre les temporalités devrait être maintenue, matérialisée au besoin par des salles d’accueil et d’attente distinctes.
En élargissant la focale, on rencontrera vite des questions philosophiques lourdes, qui portent sur le sens que nous voulons donner à la vie humaine et à la mort et sur le choix de nos priorités collectives. Le philosophe Hans Jonas a mis en lumière ces dilemmes, en 1985, dans un texte remarquable intitulé L’art médical et la responsabilité humaine (1). Il y insiste par exemple sur le fait qu’une politique médicale ne concerne jamais les seuls médecins mais bien la société dans son ensemble. En outre, les choix qu’opère cette politique implique une discussion éthique, qui porte notamment sur le bien commun, le bon usage des technologies, les objectifs prioritaires. La première urgence, c’est de réfléchir.
(1) Hans Jonas, L’art médical et la responsabilité humaine. Tr. Fr. Eric Pommier (Editions du Cerf, 2012)





