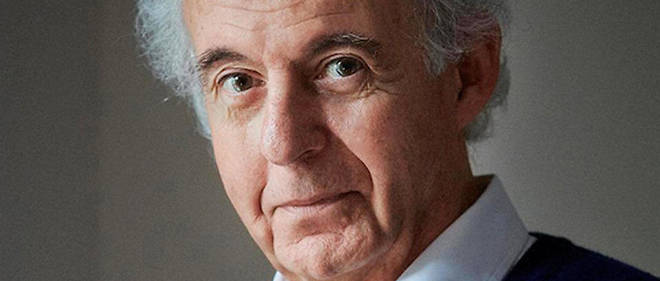Schopenhauer fils de l’Inde
par Roger-Pol Droit
Schopenhauer et l’Inde ont pratiquement le même âge. Cette affirmation signifie simplement que la jeunesse du philosophe et la découverte savante des doctrines indiennes par l’Europe coïncident. Arthur naît à Hambourg en 1788, l’année même où la Société asiatique du Bengale inaugure, à Calcutta, la publication de ses travaux. Ceux-ci vont métamorphoser la culture européenne : les premiers volumes de ces Asiatick (sic) Researches sont réédités à Londres en 1800, traduits en allemand en 1802, en français en 1803, et seront lus par Schelling*, Fichte*, Hegel*, Novalis*, Schleiermacher* et bien d’autres, dont évidemment Friedrich Majer (px), qui fera découvrir la pensée brahmanique à son jeune étudiant.
En 1801 – Arthur a 13 ans – l’orientaliste français Anquetil-Duperron* publie, sous le titre Oupnek’hat, sa traduction latine des Upanishad* d’après une version persane. Schopenhauer va s’en enticher, passionnément, quelques années plus tard. Plusieurs œuvres majeures du domaine sanskrit ont commencé à être traduites et diffusées, notamment la Bhagavad-Gîtâ* et Les Lois de Manou*. Les Veda* sont mis en lumière pour la première fois par le Britannique Henry Thomas Colebrooke en 1805. Schopenhauer apprend donc à penser en un temps où l’Inde exerce, dans le paysage philosophique, une fascination générale. Dans la décennie 1810, où s’élabore Le Monde comme Volonté et comme représentation, les chaires de sanskrit se multiplient dans les universités d’Europe presque aussi vite que les fantasmes indianophiles. Quand Schopenhauer annonce, dans son livre fondateur de 1819, que « la sagesse indienne (..) transformera de fond en comble notre savoir et notre pensée », quand il voit dans cette connaissance nouvelle « le plus réel avantage que ce siècle encore jeune ait sur le précédent » et prophétise l’avènement prochain d’une véritable « renaissance orientale », il n’est d’abord, somme toute, que le fils de son temps.
Là où il se singularise, c’est en proclamant le rôle décisif tenu par l’Inde dans la genèse de sa propre pensée. Kant*, Platon*, et le Veda – lu au prisme des Upanishad – sont considérés par Schopenhauer comme les conditions de sa propre pensée. Il est bien le seul, parmi les philosophes de sa génération, à en dire autant. Les autres admirent l’Inde, parfois la critiquent, comme Hegel, mais personne ne revendique ainsi d’être, au moins partiellement, un fils de l’Inde. Mais laquelle ? Une Inde avant tout mystique et non dualiste*, où Schopenhauer trouve – ou imagine trouver – des points d’appui. Il y puise – ou croit le faire – de quoi concevoir comment « le monde est ma représentation », et non pas une matière solide indépendante des consciences, comment sujet et objet peuvent ne faire qu’un, et surtout combien le principe d’individuation* n’est qu’illusion – point crucial pour pénétrer la nature profonde de la pitié, et lui faire jouer le rôle de fondement de la morale. De ce point de vue, il existe effectivement une relation ou un parallélisme – qui restent à examiner – entre l’intuition fondatrice de sa pensée et des doctrines comme celle du Vedanta non-dualiste (Advaïta-Vedanta) de Shankara qui affirme que tout et son contraire se trouvent inclus – sans distinction, sans dualité – dans la conscience cosmique du « sujet éternel de la pure connaissance ».
Seule cette Inde « idéaliste », « intuitive », uniquement brahmanique*, intéresse donc Schopenhauer, et pour une part l’influence. Ni les matérialistes ni les logiciens ne l’attirent, bien qu’ils soient présents dans le domaine sanskrit, et que son époque les connaisse. D’autre part, son attachement à l’Inde semble affectif plus qu’intellectuel. Il ne s’est jamais donné la peine d’apprendre le sanskrit, ce que firent bon nombre de ses contemporains, à commencer par les frères Schlegel*. Enfin, il n’est pas question, dans la genèse de sa pensée, de la moindre influence du bouddhisme.
Pour cette raison très simple : la découverte du bouddhisme par les savants européens est postérieure. Avant la décennie 1820-1830, le bouddhisme, en Europe, n’est qu’un nom, pas une doctrine. Son histoire, son expansion, son unité comme sa pluralité, ses spécificités et ses textes demeurent ignorés. Schopenhauer élabore, à Dresde, de 1814 à 1818, son œuvre fondatrice, il n’a donc pu en recevoir une réelle inspiration. De rares informations, concernant la seule Birmanie, lui ont été fournies par le Voyage de Samuel Turner à la cour de Teshoo Lama (1801) et par l’article de Buchanan (On the religion of the Burmas) publié dans le Tome VI des Asiatic Researches. Peu de choses.
Tout change dans les deux décennies suivantes. Eugène Burnouf et Christian Lassen déchiffrent la langue pâli (1826), donnant accès aux canons bouddhistes du Petit Véhicule*, Isaac Jacob Schmidt publie ses travaux sur les Mongols (de 1824 à 1829), ouvrant la voie à la compréhension du Grand véhicule*, B.H Hodgson fait connaître les écoles du Népal (de 1828 à 1841), Csoma de Körös défriche le domaine tibétain (1832-36), Charles de Rémusat le domaine chinois (1838). Le maître-livre d’Eugène Burnouf (Introduction à l’histoire du buddhisme (sic) indien, 1844) commence à relier ces multiples fils aux sources sanskrites. Les premières synthèses paraissent seulement dans la décennie 1850, comme A Manual of Buddhism du britannique Spence Hardy (1853), Die Religion des Buddha de l’allemand Köppen (1857). Et Schopenhauer suit de près ces publications. Ses allusions et références au bouddhisme s’accroissent dans les suppléments du Monde comme Volonté et comme représentation (1844), puis dans les Parerga (1851), dans la seconde édition de De la volonté dans la nature (1854), jusqu’aux multiples ajouts figurant dans l’ultime édition du Monde. (1859).
Sur le fond, existe-t-il, entre sa doctrine et celle du Bouddha, une « admirable concordance » ? Schopenhauer la souligne à maintes reprises, avec contentement, et non sans complaisance. Mais la question reste difficile à démêler, au point que même de bons spécialistes s’y sont trompés, allant jusqu’à parler, comme G.R. Welbon (The Buddhist Nirvâna and its Western interpreters. The University of Chicago Press, 1968.), d’un « accord absolu avec la perspective bouddhique ». Or ce n’est pas le cas, et de très loin. Certes, comme les bouddhistes, Schopenhauer croit à la métempsycose, privilégie le chemin du détachement pour atteindre la délivrance, peut être considéré à la fois comme mystique et comme athée. De manière encore plus décisive, plusieurs affirmations centrales du bouddhisme semblent effectivement consonner avec celles de Schopenhauer : toute vie est souffrance, le monde est impermanent, les individus sont des illusions, une morale immanente est possible, le salut n’est pas descriptible, l’histoire est inessentielle.
Mais il ne faut pas sous-estimer les divergences. Car le Bouddha vise à guérir la vie de son malaise (sinon l’Eveil* n’aurait aucun sens, ni la « doctrine-médecine » du Bouddha), alors que Schopenhauer rêve de guérir de la vie, qu’il juge inéluctablement souffrante. Le Bouddha n’est pas pessimiste. Schopenhauer l’est. En réalité, Schopenhauer a lancé une OPA philosophique sur le bouddhisme. Il a voulu faire des bouddhistes les premiers schopenhauériens, leur attribuant un pessimisme et un nihilisme* qui étaient les siens, et non les leurs. La postérité de cette annexion fut considérable, déterminant, déformant la vision du bouddhisme de Nietzsche, de Freud et de très nombreux penseurs. Il en reste de multiples vestiges.
Roger-Pol Droit, philosophe, écrivain, journaliste, auteur, entre autres, de L’oubli de l’Inde. Une amnésie philosophique (PUF, 1989, Seuil, Points, 2003) et Le culte du Néant. Les philosophes et le Bouddha (Seuil, 1997, Points 2004). Il a également dirigé Présences de Schopenhauer, Le livre de Poche, 1991.
Ce qu’il dit de l’Inde
« Je ne crois pas, je l’avoue, que ma doctrine aurait pu naître avant que les Upanishad, Platon et Kant aient pu jeter simultanément leurs rayons dans l’esprit d’un homme. » (Der handschriftliche Nachlass, I, 422)
« Le lecteur aurait-il, en outre, reçu les bienfaits du Véda auquel les Upanishad nous ont donné accès, ce qui constitue, à mes yeux, le plus grand avantage sur touts les autres précédents de ce siècle encore jeune, car je soupçonne que l’influence de la littérature sanskrite ne sera pas moins profonde que ne le fut celle de la littérature grecque au XVe siècl, à l’époque où elle fut réanimée : le lecteur, dis-je, qui a donc été initié et sensibilisé à l’ancestrale sagesse indienne, ce lecteur aura reçu la parfaite préparation pour entendre ce que je m’apprête à lui exposer. »
Le Monde comme Volonté et comme représentation, première édition (1818)
Ce qu’il dit du bouddhisme
« Si je voulais voulais voir dans les résultats de ma philosophie la mesure de la vérité, je devrais mettre le bouddhisme au-dessus de toutes les autres religions »
Le Monde comme Volonté et comme représentation, deuxième édition (1844)
« Cette concordance (Übereinstimmung) m’est d’autant plus agréable que ma pensée philosophique a certainement été libre de toute influence bouddhiste. »
Le Monde comme Volonté et comme représentation, deuxième édition (1844)