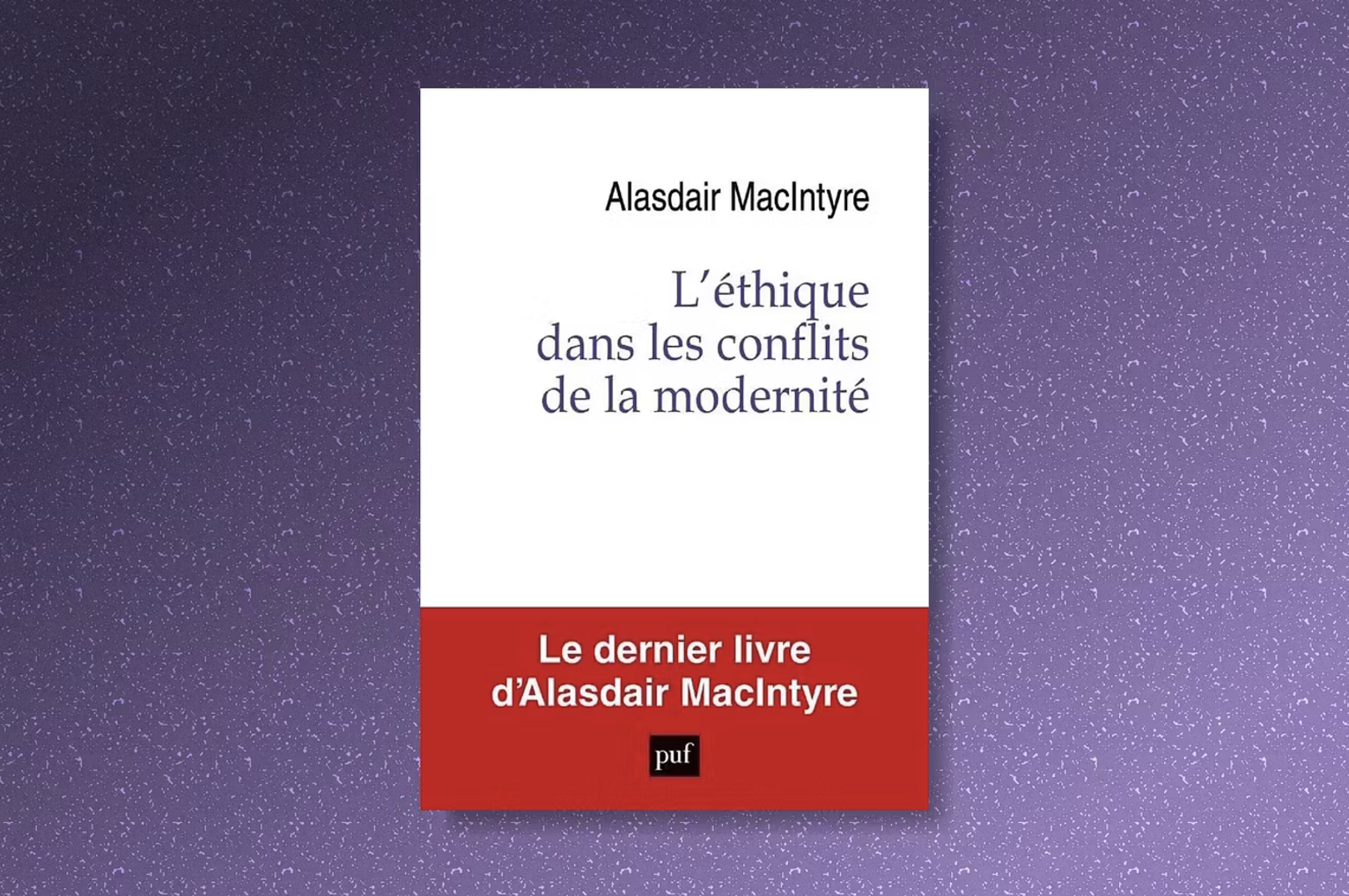« J’ai l’impression d’être comme fou. » La lettre, rédigée à côté de Salzbourg, est datée 16 août 1912. Ludwig Wittgenstein a 23 ans. Le jeune homme de génie, qui va révolutionner la logique et transformer la philosophie contemporaine, s’adresse un autre génie, son maître et ami, bientôt son adversaire intellectuel, Bertrand Russell. Dans la page couverte par cette brève missive cohabitent une remarque sur Mozart et Beethoven, « véritables fils de Dieu » (probable réminiscence du Faust de Goethe), des explications algébriques sur le calcul des propositions et, en post-scriptum, cet aveu d’une folie côtoyée et redoutée.
Fréquemment, la crainte d’une disparition, indéfinie mais irrémédiable, semble hanter le jeune philosophe : « J’ai très souvent le sentiment indescriptible que tout mon travail est à coup sûr destiné à se perdre », écrit-il un an plus tard. Dans une autre lettre à Russell, la première formule revient, plus précise : « J’ai souvent l’impression de devenir comme fou. » Aux alentours de Noël 1913, écrivant cette fois en allemand, Wittgenstein confie : « Mon humeur change tous les jours : un jour je crois devenir fou, le lendemain je redeviens totalement flegmatique. Mais au fond de mon âme tout bouillonne sans cesse comme au fond d’un geyser. Et je continue toujours à espérer qu’un beau jour une éruption se produira enfin et que je deviendrai un autre homme. »
On l’a sans doute déjà compris : il y a deux manières de lire ce gros volume, qui rassemble près de 600 lettres adressées par Wittgenstein, tout au long de sa vie (1889-1951), à une pléiade de grands intellectuels. La première consiste à considérer ces archives – réellement exceptionnelles – comme une mine d’informations sur l’histoire des idées au XXe siècle. En effet, les échanges de Wittgenstein avec Russell, mais aussi avec le logicien Gottlob Frege, le philosophe George Edward Moore, les économistes John Maynard Keynes et Piero Sraffa – excusez du peu… – constituent une documentation de première main relative aussi bien à la genèse de ses pensées qu’aux courants majeurs de l’époque. D’autant plus que bien d’autres destinataires importants figurent parmi cet ensemble.
Voué à être solitaire
Mais cette lecture historienne, presque froide, n’est pas la seule praticable. On peut aussi, au fil des pages, approcher les turbulences d’une âme tendue, fiévreuse, exigeante, tour à tour enthousiaste et inquiète, tantôt désarmée et tantôt suraiguë. Par exemple, Wittgenstein comprend vite, mais explique peu à peu à Russell qu’ils ne seront jamais d’accord. Leurs échanges d’arguments seraient vains : la disparité de leurs approches du monde est insurmontable. Le penseur est tellement honnête, exigeant et à vif qu’il préfère carrément rompre avec son maître et ami plutôt que de poursuivre une discussion théorique qu’il juge sans issue.
Wittgenstein sait combien celui qui vit tout entier pour la pensée, sans faire semblant, est voué à être solitaire. « Dans la situation honteuse et déprimante d’aujourd’hui, j’ai l’impression de devoir traiter de problèmes philosophiques avec des gens qui ne s’y intéressent guère, en réalité… », écrit-il à von Wright en 1939. Rien de nouveau dans ces affres du génie ni cette solitude du penseur de fond. Toutefois, en philosophie, les textes de Nietzsche mis à part, il n’est sans doute pas d’autre exemple d’un parcours où ces singularités soient si visibles, presque palpables.
Correspondance philosophique, de Ludwig Wittgenstein, édité et traduit de l’allemand par Elisabeth Rigal, Gallimard, « Bibliothèque de philosophie », 910 p., 39 €.