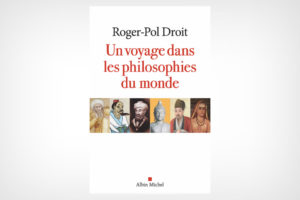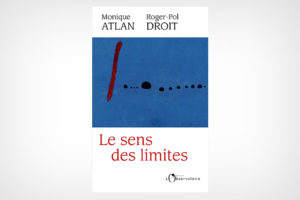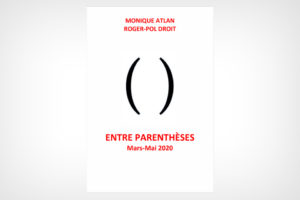Voyage en Tyrannistan

Les siècles passent, ce pays demeure. Il s’étend en archipel, d’un continent à l’autre, toujours renouvelé, dans le fond immuable. Des électrodes remplacent le fer rouge, la torture, elle, ne change pas. Les mouchards ne sont plus des mercenaires, mais des caméras ou des puces, le Web se charge de la propagande, mais le contrôle et la manipulation, globalement, restent les mêmes.
Dans cet archipel du Tyrannistan – disséminé dans le passé, le présent, l’Orient et l’Occident -, la vie quotidienne n’obéit pas à des lois. Les pouvoirs sont tous rassemblés entre les mains d’un seul. Il confond trésor public et fortune personnelle, politique et caprices, raison d’Etat et délire narcissique. Son rêve : l’impunité – en tenant les tribunaux, croit-il, on n’a pas à craindre la justice. Son quotidien : la mégalomanie – rien n’arrête son appétit de gloire et de reconnaissance, sa volonté de soumettre les autres à son désir.
Pareille persistance des tyrans n’étonne pas assez. Pourquoi leur cirque ne fait-il jamais relâche ? Comment comprendre l’absurde et le grotesque sans cesse recommencés, ces forfaits cycliques perpétrés sous des habits divers, de la Grèce antique à la planète actuelle ? Questions presque insolubles, et pourtant inévitables. Car il faut bien chercher ce qui peut expliquer un si durable chaos. Discerner ses commencements pourrait aider. Les gens de l’Antiquité, sur ce point, ont leur mot à dire.
Self-made king. « Tyran » est un terme grec. Ni Homère ni Hésiode ne l’emploient. « Tyrannie » apparaît pour la première fois chez un poète du VIIe siècle avant notre ère, Archiloque de Paros, pour désigner cette nouveauté politique qui va se répandre : la conquête du pouvoir par un individu que rien ne permettait d’attendre à cette place. Le pouvoir royal se transmet héréditairement. Le tyran, au contraire, conquiert l’autorité suprême par ses propres forces. Self-made king, si l’on ose dire, il s’installe à force de manoeuvres, profite des circonstances, utilise les points faibles de la cité. Elément essentiel : ayant gagné le pouvoir politique, le tyran le considère comme son bien, sur lequel il n’a de comptes à rendre à personne.
Les Grecs soulignent que ce battant n’est pas nécessairement un monstre. On connaît mal le détail du règne des tyrans de première génération, mais des textes anciens créditent certains d’un bilan que l’on dirait globalement positif. Deux d’entre eux, Pittacos de Mytilène et Périandre de Corinthe, figurent même parmi les Sept Sages. Les traits du tyran se noircissent chez les philosophes de la période classique. Platon, le premier, souligne combien cet homme avide confond son désir et le droit, ses plaisirs et le bien commun. Transformé en loup par le goût du sang, il organise « la servitude la plus étendue et la plus brutale », écrit le philosophe dans « La république ». Son élève et adversaire, Aristote, ne dit pas autre chose. Il explique à son tour, dans « Les politiques », comment le tyran « exerce un pouvoir irresponsable sur des hommes qui sont égaux ou supérieurs à lui, en vue de son propre intérêt et non de l’intérêt des gouvernés ».
Quand la folie guette. Voilà des traits fixés pour longtemps. Pouvoir personnel, cruauté et démesure se retrouvent de siècle en siècle. Ce que les Grecs dénommaient hubris – démesure et déraison – découle sans fin de l’absence de limites du pouvoir tyrannique : la volonté de cet individu devenu Etat en couverture Roger-Pol Droit philosophe, écrivain et chercheur au CNRS 34 | 4 août 2011 | Le Point 2029 Khanh Renaud n’est bornée par rien – ni contre-pouvoirs, ni lois, ni normes morales. Donc, la folie guette. Plus encore que l’irrationalité, paranoïa et délire des grandeurs sont monnaie courante. On les retrouve chez les empereurs de Rome, comme plus tard chez ceux de Russie ou de Chine. Toujours et partout s’y greffe aussi un étrange comique, fait d’absurde et d’excès mêlés à l’effroyable. Le pouvoir suprême : garder pour soi « la moitié des impôts », mais aussi « manger fort souvent de l’andouille et rouler en carrosse par les rues », comme Alfred Jarry le fait dire au Père Ubu en 1896.La figure du tyran semble immuable. Née chez les Anciens, elle change peu avec les Modernes. « Là où le droit finit, la tyrannie commence », écrit Locke en 1690. En 1764, à l’article « tyrannie » de son « Dictionnaire philosophique », Voltaire décrit, une fois de plus, un « souverain qui ne connaît de loi que son caprice, qui prend le bien de ses sujets, et qui ensuite les enrôle pour aller prendre celui des voisins ». Montesquieu, entre-temps, dans « De l’esprit des lois » (1748), explique comment « un seul, sans loi et sans règle, entraîne tout par sa volonté et par ses caprices ». Pourtant, cette fois, ce n’est pas du tyran qu’il parle, mais du despote.
Entre tyran, despote et dictateur, quelle différence ? On risque de s’épuiser à vouloir trouver à tout prix de puissantes distinctions. Car les traits communs l’emportent sur les différences, à tel point que les trois termes sont presque synonymes. Grosso modo, le tyran est antique, le despote classique, le dictateur moderne, mais la structure est la même. A condition, bien sûr, de ne pas négliger quelques différences d’échelle et de système. Dans les totalitarismes contemporains, Staline, Hitler ou Mao exercent leur tyrannie personnelle, mais au sein d’un système impersonnel, dont ils sont les produits autant que les maîtres.
Jouissance de l’asservissement. Malgré tout, on se tromperait en croyant qu’il n’y a vraiment rien de nouveau au pays des tyrans. Car le regard que nous portons sur eux a changé. Nous savons désormais qu’ils ne sévissent pas seulement chez les autres. Longtemps, en effet, tyrans et despotes furent avant tout des animaux orientaux, des barbares, des gens lointains. L’Empire perse, pour les Grecs, était le haut lieu du despotisme, Montesquieu réinvente le « despotisme oriental », Marx à son tour reprend et transforme ce vieux fonds. A l’inverse, nous avons appris du XXe siècle que le pire est aussi chez nous.
Nous avons aussi entrevu l’existence du désir de servitude. Car le tyran ne pourrait réussir et survivre si ses sujets n’étaient pas habités, peu ou prou, de l’envie d’être dominés. Ce consentement à la domination, cette jouissance d’être asservi constituent des vérités si désagréables à envisager qu’on a rarement tenu compte, avant le XXe siècle, du petit traité qui les met en lumière, le « Discours sur la servitude volontaire », d’Etienne de La Boétie. Ce qu’incite à penser, dès la Renaissance, l’ami de Montaigne, c’est bien que l’autonomie, la démocratie, la volonté de disposer soi-même de son destin ne sont pas de grandes forces spontanément partagées. Elles doivent s’éduquer, entrer en lutte avec l’inclination obstinée à se coucher devant les maîtres et les puissants.
Enfin, dernier malaise auquel les tyrans nous confrontent, la place même de la philosophie est à questionner. Car on a cru trop vite l’affaire réglée, et trop facilement : d’un côté les méchants tyrans, de l’autre les bons philosophes. Les uns despotes, les autres forcément du côté du peuple. Voilà une nouvelle erreur, car la complicité entre philosophes et tyrans est une affaire ancienne et tortueuse. C’est ce qu’a montré un bel essai de mon regretté ami Christian Delacampagne (« Le philosophe et le tyran », PUF, 2000). Ce philosophe roi dont rêve Platon ? Un tyran qui croit gouverner au nom de la vérité. Comme feront, à leur tour, Staline, Hitler, et tant d’autres. En fin de compte, si on regarde de près, pas mal de tyrans ont des allures de philosophes manqués. Et bien des philosophes, quand on gratte le vernis, se révèlent tyrans ratés.
A chacun de décider, en son for intérieur, dans quelle mesure il s’agit là de mauvaises ou de bonnes nouvelles.
L’artiste face aux tyrans
Si l’art est un contrepouvoir, c’est plus que jamais le cas à Dinard, qui accueille jusqu’au 11 septembre l’exposition » Big Brother. L’artiste face aux tyrans « . Yan Pei- Ming y croque définitivement Mao (ci- dessus, » L’artiste et son tyran « , 2011), Joana Vasconcelos braque une voiture à l’aide de fusils en plastique, André Butzer peinturlure Himmler… De la subversion utilisée contre les formes les plus abouties du totalitarisme. Palais des arts et du festival, 2, boulevard Wilson, Dinard (Ille-et-Vilaine). Renseignements au 02.99.16.30.63.